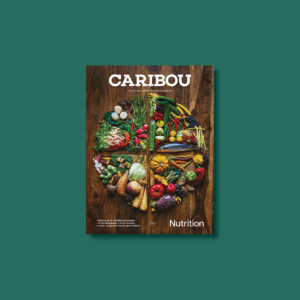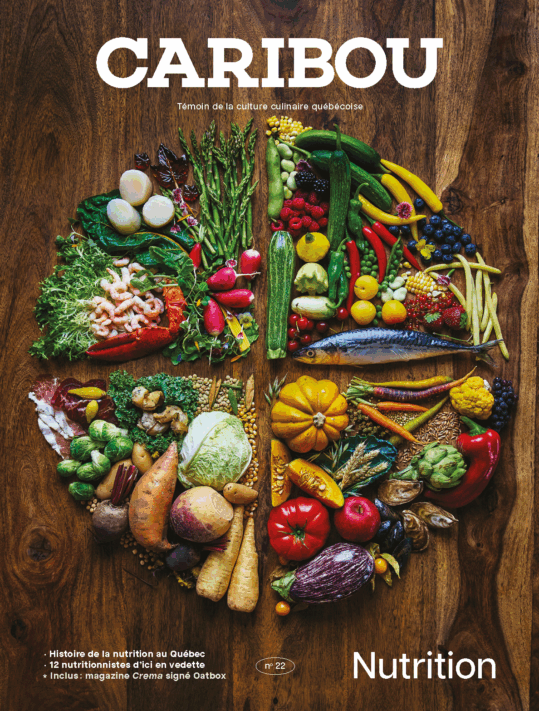Rien ne se perd, tout se mange
En théorie, tout du homard peut être consommé, même si «en ville», on s’arrête souvent aux pinces et à la queue parce que les homards sont petits et que leur chair est plus difficile à extraire. Cependant, en Gaspésie, le homard est costaud: «Ici, les gens lèvent le nez sur les homards en bas de deux livres, admet François Pichette, directeur de la production à l’usine de la Poissonnerie Carleton dans la Baie-des Chaleurs, en riant. Les “gens de la ville” font parfois le saut quand ils voient nos beaux gros homards!»
Si vous êtes invité à un repas de homards en compagnie de Gaspésiens, il y a de fortes chances qu’ils se chamaillent pour savoir qui aura «le rouge», c’est-à-dire les œufs en formation de la femelle, et «le vert», qui assume les fonctions du foie et du pancréas. «C’est comme du caviar, c’est très prisé», explique François Pichette, qui ajoute que ce ne sont habituellement que les habitants de la région et les consommateurs avertis qui connaissent cette information.
Du beurre et autres accompagnements
Oui, les Gaspésiens aussi mangent leur homard avec du beurre à l’ail! Comme plats d’accompagnement, certains aiment servir leur crustacé avec des salades de type pique-nique, comme une salade de chou, de macaroni ou César.
Et s’il reste de la chair, chose qui est très peu probable, on en fait des guédilles ou un club sandwich. Avec la carapace, François Pichette suggère de faire un bouillon: «Je fais bouillir la tête et la carapace dans de l’eau. Cela fait une très belle base pour une soupe au poisson.»
Ne soyez pas surpris si…
… vous tombez sur un homard noir, qu’on appelle homard de roche, explique François Pichette. La carapace de ces homards frotte contre les roches dans l’eau et cela use leur épiderme, d’où leur couleur noire. Ces homards sont souvent très viandeux, parce que les roches leur offrent un milieu idéal pour s’alimenter.
Le «rouge» et le «vert»
Ces expressions désignant des parties du homard sont utilisés couramment. Mais, selon les villages, les Gaspésiens n’emploient pas tous les mêmes termes. Vers Chandler et ses environs, par exemple, les habitants appellent le «vert» du «fort» et le «rouge», de la «rave». Mais qu’on dise «vert» ou «fort», il peut être intéressant de savoir que le vrai mot est «tomalli». Quant au «rouge», ou «rave», le terme juste est «corail».
Comment différencier les mâles des femelles?
Pour s’assurer de déguster de la «rave», il faut des femelles! Il existe deux façons de différencier les mâles des femelles. Premièrement, on observe la queue du homard; celle de la femelle est toujours plus large, car elle contient des œufs. Sinon, on peut faire une vérification plus précise en regardant sous l’abdomen; en étalant la queue du homard, on aperçoit des appendices qui ressemblent à de petites nageoires. Ce sont les pléopodes, et il y en a cinq paires. La première paire, celle qui se trouve dans la partie supérieure de la queue, est différente des quatre autres. Si ces petites nageoires sont molles et souples, il s’agit d’une femelle. Si elles sont dures et pointues, c’est un mâle.
Pour chaque partie un plaisir différent!
La queue, les pinces, le corps… Le plaisir de manger un homard réside dans l’expérience gustative; chaque partie de celui-ci a une texture et un goût différents. C’est pourquoi il ne faut pas hésiter à tout manger. Par exemple, le homard est muni de petites pattes marcheuses situées de chaque côté du corps; huit au total. Pour les Gaspésiens, ces péréiopodes marquent le début de la dégustation. Il suffit d’attraper une petite patte avec les mains et de tourner en tirant. Ensuite, on croque la carapace et on suce ! Cette façon de faire très typique indique aussi si le homard est bien cuit, bien salé et bien rempli. Les Gaspésiens appliquent la même technique pour déguster les uropodes, les petits segments en éventail qui se trouvent au bout de la queue.