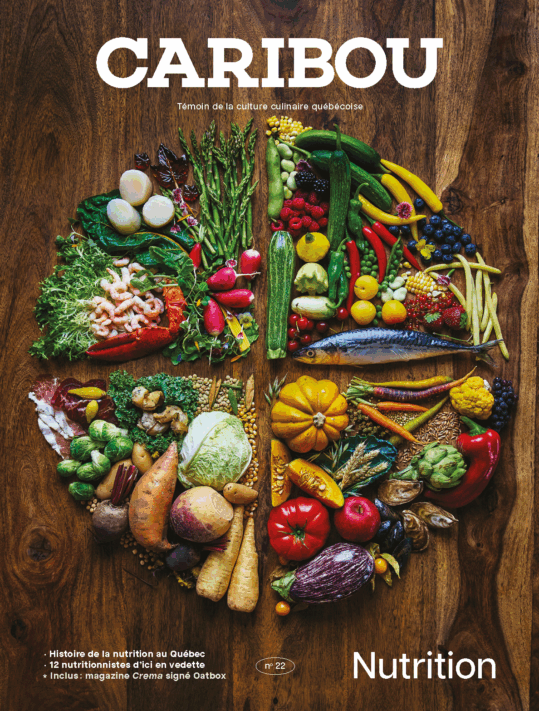Cultiver ensemble pour renforcer les liens sociaux
Publié le
01 septembre 2025
Texte de
Joanie Rathé

La Fédération des sociétés d’horticulture et d’écologie du Québec (FSHEQ) soutient, grâce au programme Horti-Aînés, des projets d’agriculture urbaine destinés aux personnes âgées. Les sociétés membres peuvent soumettre une initiative locale, que la fédération finance selon ses moyens. L’objectif? Favoriser l’autonomie, stimuler la curiosité et briser l’isolement. «Certains participants ont de l’expérience, d’autres découvrent le jardinage sur le tard. Ce qui les unit, c’est le plaisir de jardiner à plusieurs, d’apprendre et de s’entraider», souligne Annie Houle, directrice générale de la FSHEQ.
Les projets prennent mille et une formes. À Alma, on fleurit les balcons des résidences pour personnes âgées. À Beauceville, on s’initie à la création de terrariums, tandis qu’à Dolbeau-Mistassini, on fabrique des cadres végétaux sur rondins. À Repentigny, les potagers communautaires se garnissent de vignes à raisins, de fleurs comestibles et de fines herbes.
Une ferme à échelle humaine
À la Ferme Jeunes au Travail (FJAT), à Laval, l’agriculture devient un prétexte pour se reconnecter à soi et aux autres. Chaque année, des personnes de 16 à 35 ans vivant des difficultés s’y investissent pour quelques mois en été, encadrées par une équipe psychosociale. «Ici, l’agriculture devient un levier de réinsertion, et la réinsertion, un moteur pour cultiver la terre», résume Yann Beurdouche, directeur général.

Le programme permet à ces jeunes de toucher à du concret, de voir le fruit de leurs efforts et d’en tirer une réelle fierté. Ils y apprennent à travailler la terre et à cuisiner et touchent même à l’ébénisterie. Les participants développent ainsi des compétences pratiques, reprennent confiance en eux et se sentent intégrés. «On observe des résultats sur le plan de l’employabilité, mais surtout des retombées individuelles et relationnelles», souligne Christophe Dubois, coordonnateur de l’équipe d’intervention.
C’est un travail qui demande une grande collaboration. En agriculture, on vise souvent une production importante qui nécessite un rythme assez rapide. Or, à la FJAT, «on prend le temps de ralentir pour favoriser le développement des liens humains», souligne Marie-Charlotte Desjardins, responsable de la production agricole.
Des récoltes importantes
Sur le terrain, les retombées de ces initiatives sont bien réelles. Du côté de la FSHEQ, grâce au programme Horti-Aînés, des dizaines de projets ont vu le jour dans des résidences, des maisons des aînés et des milieux communautaires partout au Québec. En 2024, 9 projets ont permis d’atteindre 946 personnes. Et déjà, en 2025, 10 projets impliquant 972 personnes sont en cours, alors que l’année n’est pas encore terminée.
Le bilan est tout aussi positif pour la FJAT. «Dans la dernière année, 47 jeunes ont participé au programme. Parmi eux, 17 ont terminé leur parcours avec succès et 16 ont obtenu une certification reconnue par le ministère de l’Éducation en agriculture ou en cuisine», précise Yann Beurdouche. Deux anciens participants sont même aujourd’hui employés à la ferme.

Derrière chaque initiative, rappelons que les défis sont bien réels: financement, ressources humaines, pérennité. Les organismes maximisent chaque dollar, chaque partenariat, chaque heure de bénévolat. Les retombées, quant à elles, se manifestent de façon concrète, durable et profondément humaine. Dans un monde où tout va trop vite, jardiner devient un acte de résistance douce, une façon de se reconnecter au moment présent.
Des projets comme ceux du programme Horti-Aînés ou de la FJAT redonnent du sens à l’acte de semer en cultivant aussi l’autonomie, la dignité, l’entraide… Et les récoltes, elles, bénéficient à l’ensemble de la communauté.
Et si on s’y mettait?
Envie de jardiner et d’aider ? Des projets comme la FJAT, ceux de la FSHEQ et d’autres partout au Québec accueillent volontiers des bénévoles. Quelques heures suffisent pour avoir un effet réel. En voici quelques exemples:
- Nutri-Centre LaSalle (Montréal) est un carrefour communautaire qui aide les personnes vulnérables. De mai à octobre, son jardin collectif accueille des bénévoles pour jardiner, socialiser et partager des connaissances.
- Les Jardins de la Terre (Saint-Paul-d’Abbotsford) offre un programme d’insertion en emploi pour jeunes adultes. Journées de bénévolat régulières pour aider à la récolte, au désherbage, etc. Dates annoncées sur leur page Facebook ou sur appel.
- Patro Roc-Amadour (Québec) dispose d’un jardin communautaire réunissant familles, jeunes et aînés. Tâches variées adaptées aux disponibilités et aux capacités de chacun.
- Les Maraîchers du Cœur (Rimouski) veille à l’insertion sociale des personnes de 16 à 30 ans par l’entremise de la culture maraîchère. Les bénévoles participent à toutes les étapes, de la plantation à la récolte.
Plus de contenu pour vous nourrir