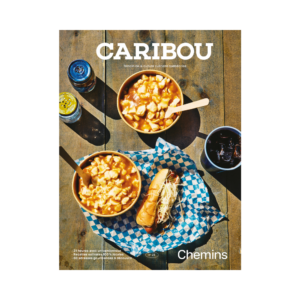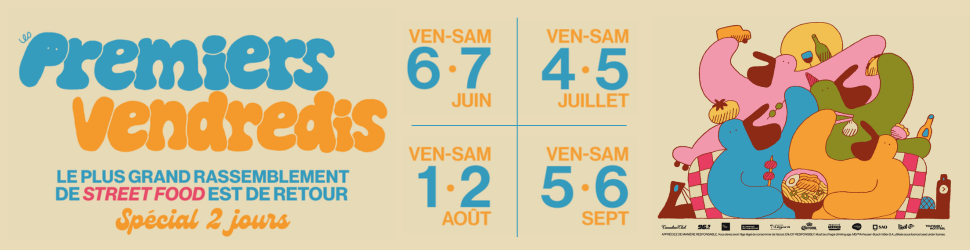Jadis, les Innus pêchaient à l’aide d’un gros hameçon aux allures d’un crochet. «On s’est rendu compte que ça pouvait faire mal aux homards», explique Edmond Mestenapeo, agent de développement économique et touristique de Winipeukut Nature. Cette organisation locale planifie des séjours d’expériences en terre innue, afin de transmettre un savoir-faire et une culture millénaire.
C’est sur l’île Apinipehekat, à quelques kilomètres à l’est d’Unamen-Shipu, que nous passons quelques jours pour mieux connaître et apprendre les us et coutumes traditionnels de la communauté. Puisqu’il ne reste que quelques semaines à la saison de la pêche au homard, c’est donc tout un privilège d’accompagner nos guides dans cette étonnante activité.
Partie de pêche
Si la pêche aux homards en cage est aussi pratiquée avec un permis de pêche commerciale ou pour des raisons de subsistance à Unamen Shipu, seuls les Innus ont le droit de pêcher le homard à l’épuisette. C’est donc à titre d’observateurs que nous partons à la pêche dans la baie devant notre campement. Dans la chaloupe, il y a deux épuisettes et une bouteille dans laquelle se trouve un liquide jaune. «C’est de l’huile de maïs, dit Edmond. On en met un peu sur l’eau pour mieux voir les homards au fond de l’eau.»
Ce tour de magie comme il dit est arrivé par hasard, alors qu’un pêcheur a vidé l’huile d’une conserve de sardines dans l’eau. Son reflet ainsi coupé par l’huile permet de mieux voir le fond de l’eau, l’idéal pour repérer le homard qui se cache souvent entre les algues ou dans la vase. Mais dans notre tête de novice, les homards ne vivent que dans les eaux froides et profondes. Il nous est donc difficile de croire que nous en verrons dans à peine un mètre de profondeur.
Edmond prend le bout de l’épuisette pour sonder le fond de l’eau. Pendant ce temps, Daniel Mark– qui est aussi une personne ressource pour identifier les plantes sauvages dans le coin – lance un jet d’huile de maïs sur la surface de l’eau. Nous voyons un peu mieux le fond de l’eau, mais aucun homard. Quelques minutes plus tard, nous commençons à craindre de rentrer bredouilles.
Le temps d’imaginer le pire scénario, Daniel aperçoit un premier homard. Il plonge son épuisette dans l’eau, la place derrière le crustacé et aussitôt qu’il sent sa présence, il recule presque directement dans le filet. En effet, le homard se déplace à reculons. En langue innue, on l’appelle d’ailleurs «ashatsheu», ce qui veut dire «qui recule». Logique!
En moins d’une heure, Daniel et Edmond réussissent à remplir le grand chaudron dans le fond de la chaloupe. Les guides de nos compagnons de voyage dans deux autres bateaux s’affairent également à attraper le souper. Et à les entendre s’exclamer, tout porte à croire que la pêche est tout aussi bonne de leur côté de la baie!