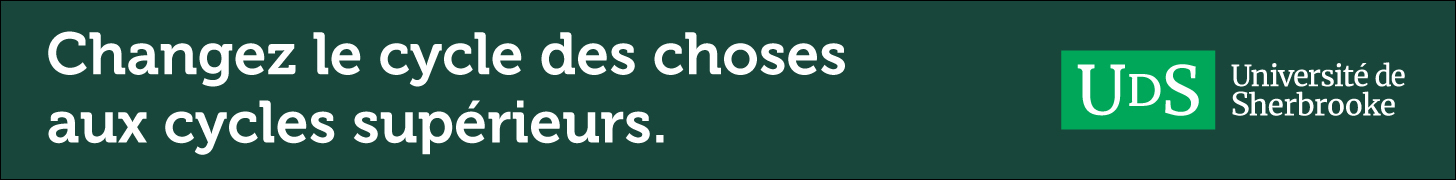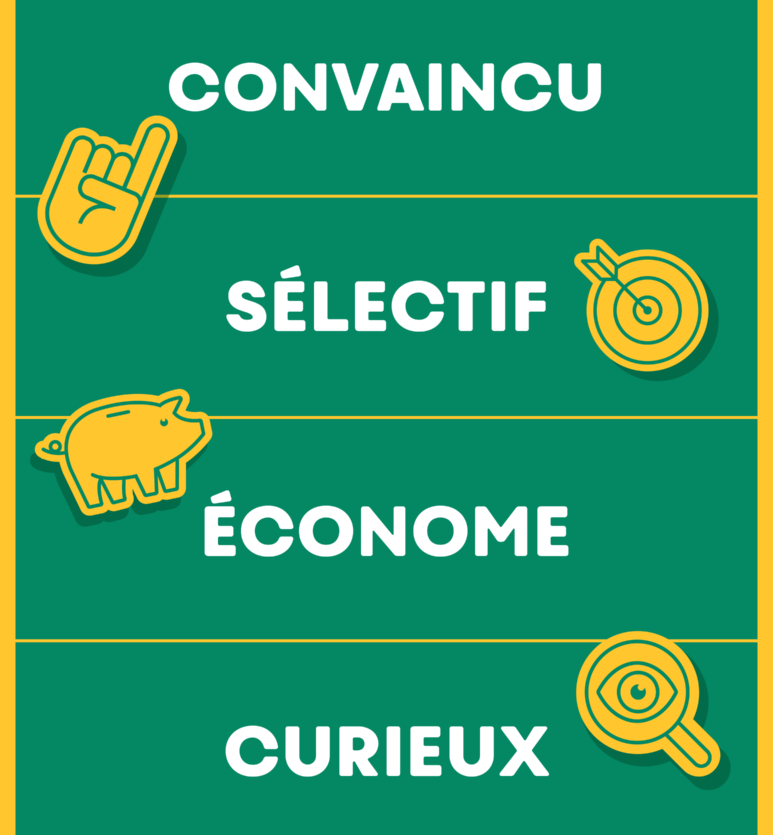La petite histoire des rivières à saumon privées
Publié le
24 octobre 2022
Texte de
Nicolas Lachapelle
Photos de
Nicolas Lachapelle

Pendant des millénaires, les Innus et leurs ancêtres ont pêché le saumon au harpon et au filet dans une relative tranquillité, prélevant la ressource selon leurs besoins du moment. La colonisation marque cependant un changement drastique dans ce mode de vie. Ce grand bouleversement atteint son paroxysme quand, en 1886, un premier club privé s’établit sur une rivière qui traverse le Saguenay–Lac-Saint-Jean et la Côte-Nord: la Sainte-Marguerite. Les principes des clubs privés sont simples: les droits sur une section de territoire sont cédés à l’usage exclusif de ses propriétaires, souvent de fortunés Américains.

Aux courants des décennies suivantes, les plus beaux secteurs de la province se voient occupés par une poignée de privilégiés qui protègent scrupuleusement leur mainmise sur ces territoires. Ils en interdisent l’accès à quiconque, les routes d’accès sont barrées et des gardiens sont postés un peu partout en périphérie. Résultat: plusieurs nations autochtones, comme la nation innue, se voient évincées des rivières qu’elles occupaient depuis des millénaires. Des régions entières du Québec sont « clubées » de la sorte et avec une telle fulgurance qu’à la fin des années 1960, on dénombre entre 2000 et 2200 clubs privés au Québec.
Le grand déclubage
En 1977, le gouvernement québécois se décide à mettre un terme à l’emprise des clubs privés sur le territoire de la province. Cette décision, qu’on a appelée le grand déclubage, est prise dans une volonté de restituer le territoire au peuple québécois. C’est à ce moment que naissent les pourvoiries telles qu’on les connaît aujourd’hui. Bien que celles-ci soient plus accessibles que les clubs privés qui les ont précédés, plusieurs premières nations s’estiment toujours lésées de leurs droits ancestraux sur les cours d’eau qui leurs étaient aussi essentiels.

Au moment du déclubage, les Innus sont toujours considérés comme des braconniers sur les rivières. Un climat anti-autochtone règne alors sur les cours d’eau de la province et donne lieu à plusieurs incidents racistes. En 1981, les gardes-pêches provinciaux mènent une vaste et violente opération contre les pêcheurs de saumon de la communauté micmacs de Listuguj en Gaspésie. Cet événement, que l’on connaît aujourd’hui comme «le raid de restigouche», met le feu au poudre dans plusieurs communautés autochtones. C’est le début de la fameuse guerre du saumon, un mouvement de réappropriation des rivières par plusieurs nations autochtones dont les répercussions se font encore sentir aujourd’hui.
C’est dans ce contexte incendiaire que plusieurs communautés, lasses de la mainmise d’intérêts étrangers sur leur territoire, prennent les choses en main et décident de se réapproprier leurs rivières. À l’été 1982, Nutashkuan, la communauté innue voisine de Natashquan, décide d’occuper plusieurs sites de pêche sportive privés sur sa rivière. L’objectif: revendiquer leurs droits sur le cours d’eau. En 1984, le gouvernement cède aux pressions de la communauté, rachète les droits des pourvoyeurs sur la rivière et les restitue au conseil de bande de Nutashkuan, créant de ce fait la pourvoirie Hipou et initiant un mouvement de réappropriation qui perdure encore à ce jour dans plusieurs régions de la province.
Pour suivre notre journaliste dans son road trip sur la Basse-Côte-Nord et pour lire son reportage à propos de l’état des rivières où on pêche le saumon, procurez-vous notre dernier numéro.

Plus de contenu pour vous nourrir