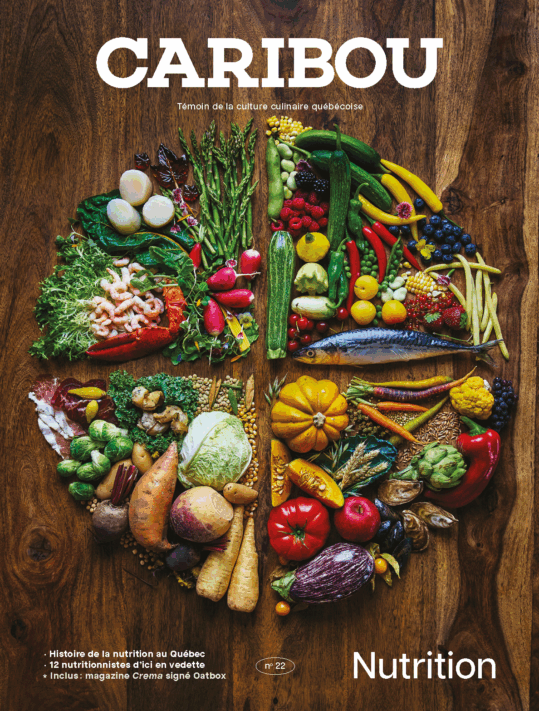Pratiquer la vannerie pour se reconnecter au territoire
Publié le
10 octobre 2025
Texte de
Virginie Landry

L’invention de la vannerie remonte à au moins 10 000 ans, ce qui fait d’elle un art plus vieux que la poterie. À l’époque, les chasseurs-cueilleurs utilisaient des végétaux qu’ils avaient à portée de main — osier, roseau, brindilles — pour tisser des paniers qui leur servaient à transporter leurs récoltes de fruits, de champignons et d’autres denrées.
«Chaque communauté du monde a développé une vannerie intimement liée à ses végétaux», énonce Laurence Thiffault, artiste vannière et fondatrice de l’atelier-boutique Sweet Mama Grass, une petite entreprise locale d’articles de vannerie installée à Sutton, dans les Cantons-de-l’Est.
Également, les Premières Nations, particulièrement les Abénakis, entretiennent depuis longtemps, et encore aujourd’hui, un amour particulier pour la vannerie faite de frêne noir et de foin d’odeur.
Sauf que depuis plusieurs décennies, ce savoir-faire artisanal a lentement cessé d’être transmis. «Est-ce à cause de l’industrialisation et de l’avènement du plastique? Du temps que ça prend pour faire un panier et de son coût? Je ne suis pas sûre», évoque Laurence Thiffault. Pour elle, c’est un fort désir d’autosuffisance et l’envie d’aller à contre-courant de la surconsommation qui l’ont menée vers la vannerie.
Tisser local
Avant de déménager sa famille dans les Cantons-de-l’Est en 2020, Laurence et son conjoint vivent leur rêve «de proximité avec le territoire et de création avec la nature» sur une terre dans le Témiscouata. En 2017, Laurence plante du foin d’odeur et s’intéresse à la vannerie, un art qu’elle ira apprendre en Europe faute de trouver des cours assez complets ici. Quelques années plus tard, elle implante sa propre oseraie (terre de saules à osier), et son amour pour la vannerie ainsi que sa production explose.
«Pour moi, la vannerie est une pratique intimement liée au territoire. Je crée avec ce que la nature m’offre en abondance. Quand un panier est brisé, je tente de le réparer ou sinon, je le redonne à la terre», déclare-t-elle avec conviction.

À son avis, toutes les plantes ont le potentiel d’être tressées, bien qu’il y en ait qui soient plus intéressantes: on utilise le saule et l’osier pour un objet plus solide, la quenouille et les herbes pour un panier plus flexible. «Je recherche principalement des végétaux avec une belle longueur, une belle couleur, mais aussi une délicate odeur», déclare l’artiste vannière, qui admet qu’un travail pourrait être fait pour approfondir les connaissances liées aux plantes locales qui se prêteraient bien à la vannerie, comme l’hémérocalle, le cornouiller ou la vigne vierge.
Fait main
Fabienne et Nathalie Clément, les entrepreneuses créatrices de la marque d’objets de vannerie en rotin Les deux sœurs dans le même panier, sont également des férues de cet art qu’elles ont appris lors d’ateliers pendant une escapade au Vermont. Depuis cette incursion dans la vannerie, Fabienne offre régulièrement des ateliers de création de paniers tissés chez Les Affutés, à Montréal.
 Nathalie et Fabienne Clément
Nathalie et Fabienne ClémentPhoto d'Isabelle Jetté
 Photo d'Isabelle Jetté
Photo d'Isabelle Jetté Elles vantent la facilité d’apprentissage de cet art manuel: «On utilise une technique très traditionnelle, le “par-dessus, par-dessous” ne nécessitant ni clou ni colle. Tout se tient parce que c’est entrelacé! On a besoin de fibres végétales préalablement séchées et de quatre outils (des ciseaux, un poinçon, un passeur et des pinces). On peut même faire ça dans notre cuisine!»
Elles expliquent qu’un panier se travaille avec des brins réhydratés, pour garder les fibres souples. Quand ça sèche, ça fige! En trois ou quatre heures seulement, on a un superbe panier de jardin ou pour aller au marché, un cabas pour la cueillette en forêt ou un petit sac à dos tressé. Et si on prend bien soin de son œuvre — «le plus grand ennemi de la vannerie, c’est la moisissure», déclare Nathalie Clément — on peut la conserver très, très longtemps.
«Les jeunes cherchent à revenir au “faire soi-même” et à adopter le zéro déchet», a remarqué Fabienne au cours des dernières années. À son avis, c’est là que «la vannerie peut prendre du galon» et se rebâtir une certaine popularité. Lentement, mais sûrement. Comme on tisse un panier.
Où apprendre ?
Ateliers Sweet Mama Grass, à Sutton
Ateliers Les Affutés, à Montréal
Ateliers Métiers & Traditions, à Longueuil
Plus de contenu pour vous nourrir