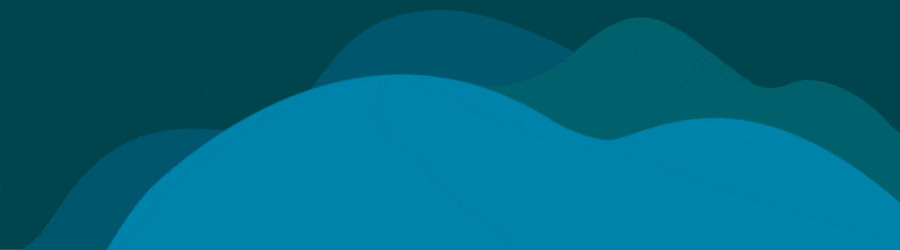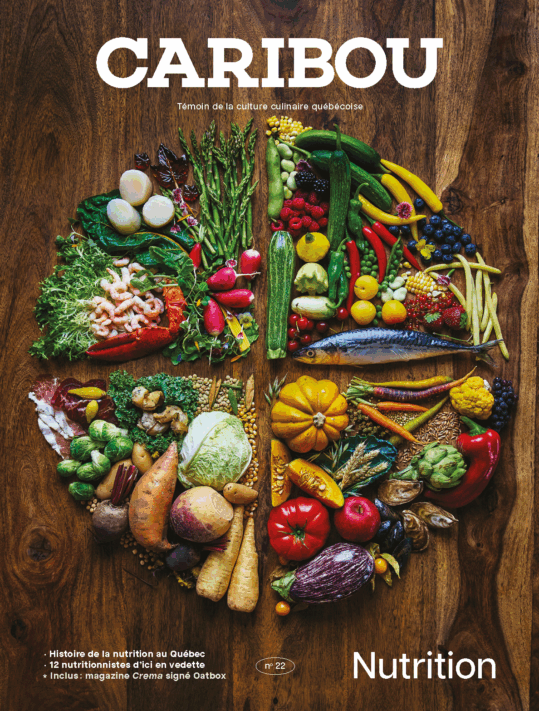Mon pays, c’est… la nordicité
Publié le
25 janvier 2019
Texte de
Véronique Leduc
Illustration par
Amélie Tourangeau

Les intervenantes:
Marie-Hélène Roch est consultante en recherche et animation de consultations citoyennes. Elle s’intéresse à la nordicité urbaine au quotidien d’ici et d’ailleurs. Ses dernières réalisations l’ont amenée au Danemark, en Finlande et en Russie.
CaoimheIsha Beaulé a récemment déménagé dans le nord de la Finlande, où elle poursuit ses investigations sur le sujet du design nordique. Elle est étudiante au doctorat dans le programme «culture-based service design» à l’University of Lapland.
— Qu’est-ce que la nordicité?
Caoimhe Isha Beaulé: Louis-Edmond Hamelin, le géographe et linguiste québécois qui a inventé le terme «nordicité» dans les années 1960, la résume par le fait d’habiter un territoire froid dans l’hémisphère Nord. Plus précisément, il dit qu’elle peut être un état, une attitude ou un mode de vie. Il a d’ailleurs mis au point un indice grâce auquel on peut évaluer la nordicité d’un territoire, au-delà de sa latitude, selon 10 facteurs.
Marie-Hélène Roch: On associe au terme nordicité beaucoup d’effets physiques, comme le gel ou le froid. La vraie question pour définir la nordicité, ce n’est pas à quelle latitude vit un peuple, mais plutôt ce que fait ce dernier des éléments nordiques dans lesquels il est plongé.
— Qui sont les grands penseurs de la nordicité au Québec?
Caoimhe: Louis-Edmond Hamelin, bien sûr, qui a inventé le mot. Avant, l’expression «pays nordiques» désignait uniquement les pays scandinaves. Lui voulait que le Québec soit inclus dans cette appellation. Selon sa perspective de géographe, il n’y avait pas de vocabulaire adéquat pour parler du Nord en français. Il a donc créé un dictionnaire d’une centaine de mots (où on trouve notamment les termes nordicité, hivernité, montagnité) pour exprimer notre territoire. Les régions francophones situées plus au sud n’avaient pas besoin de ces mots-là; il fallait les inventer au Québec. L’écrivain Jean Désy et le professeur d’études littéraires Daniel Chartier ont aussi beaucoup réfléchi à la question.
Marie-Hélène: René Lévesque, qui cherchait à unifier le Québec, a eu beaucoup d’influence sur le travail de M. Hamelin. Ensemble, ils ont fondé le Centre d’études nordiques de l’Université Laval. D’un point de vue anthropologique, Serge Bouchard, l’écrivain, animateur de radio et anthropologue, s’intéresse aussi au Nord. Sophie-Laurence Lamontagne, une ethnologue, s’est quant à elle penchée, dans les années 1980, sur les aspects culturels de notre nordicité.
Caoimhe: Il y a quelques années, grâce au travail de Louis-Edmond Hamelin, on a beaucoup réfléchi à l’aspect géographique de la nordicité. Ce qui est intéressant, c’est que maintenant, on pense aussi à ses côtés sociologique, anthropologique, culturel et artistique. Notre perception initiale de la nordicité a fait des petits!
— Quelle est la différence entre l’hiver et la nordicité?
Caoimhe: L’hiver, c’est la nordicité saisonnière. C’est une période froide, limitée dans le temps. Dans le sud du Québec, notamment à Montréal, on vit surtout cette nordicité saisonnière, et, à cause de nos étés chauds et humides, on en vient à oublier qu’on est une ville nordique. Pourtant, Montréal est la métropole la plus froide du monde!
— Justement, comment la nordicité influence-t-elle notre alimentation?
Caoimhe: On oublie que plusieurs produits n’existent que grâce à elle, dont le sirop d’érable et le cidre de glace. Pendant l’hiver, on mange des bananes ou des avocats sans se poser de questions, mais en tant que peuple nordique, on devrait se demander comment revenir à une alimentation plus locale. Il y a quand même un certain retour aux méthodes anciennes qu’utilisaient nos grands-mères pour conserver leurs aliments. La mise en conserve, le fumage et la déshydratation sont des pratiques nordiques qui ont été inventées afin de pouvoir manger à l’année des aliments qui ne sont pas offerts l’hiver.
Marie-Hélène: Il y a encore toute une éducation à faire pour réellement «se nourrir de notre nordicité». Il faudrait par exemple savoir comment cuisiner le navet pour en tirer le maximum. On a besoin de livres de cuisine et de chefs qui nous montrent comment nous amuser avec ce qui vient de chez nous. Par exemple, pensez-y: y a-t-il quelque chose de moins local que le traditionnel jus d’orange du matin? Dans le temps, nos parents recevaient une orange à Noël, et c’était super spécial. Pourquoi est-ce qu’on n’a pas plutôt pris l’habitude de boire le jus d’un fruit qu’on trouve à la tonne ici, la pomme? Malgré tout, on voit se dessiner une mouvance encourageante. Par exemple, il y a depuis quelque temps des gins élaborés à partir de pommes de terre ou de panais. Ça fait partie d’une stratégie alimentaire de développement durable.
— Est-ce que les Québécois forment un peuple nordique?
Caoimhe: L’identité des Québécois est grandement influencée par leur nordicité. Louis-Edmond Hamelin a mis des mots sur quelque chose qui existe depuis toujours. À preuve, les traces de la culture nordique sont partout, dans notre littérature ancienne, notre musique, notre héritage architectural ou nos habitudes alimentaires. Il n’y a qu’à penser à nos motoneiges ou à La guerre des tuques, par exemple. C’est quelque chose qui nous habite.
Marie-Hélène: Tous les Québécois sont nordiques, mais les autochtones du Québec le sont peut-être encore plus que les autres, de par leur histoire et leur savoir. Pour Louis-Edmond Hamelin, l’union entre le Québec du Nord et le Québec du Sud est un idéal à atteindre si on souhaite bien vivre notre nordicité.
— Comment croyez-vous que s’exprimera notre nordicité dans l’avenir?
Marie-Hélène: J’espère que ça dépassera le contexte événementiel. On a de grands rassemblements, comme les carnavals et l’Igloofest, qui prouvent qu’on aime célébrer l’hiver, mais ce serait le fun que la nordicité soit plus intégrée au quotidien. Je pense aussi qu’il faut en venir à ralentir notre rythme pendant l’hiver, à nous adapter à ce qu’il demande. Pour mieux vivre notre nordicité, il faudrait qu’on soit plus connectés à notre environnement.
Caoimhe: Il y a un intérêt grandissant pour le sujet. J’espère que d’autres projets verront bientôt le jour pour valoriser la culture autochtone. C’est une richesse immense dont le Québec devrait être fier et à laquelle il devrait assurer un espace, afin que les Premières Nations et les Inuits puissent s’émanciper. Tout ça part d’une volonté politique, sociale et citoyenne.
La nordicité en 10 facteurs
En 1976, Louis-Edmond Hamelin a déterminé 10 facteurs permettant d’évaluer le degré de nordicité d’un lieu et de voir s’il appartient à une des quatre catégories suivantes: le pré-Nord, le Moyen Nord, le Grand Nord ou l’Extrême Nord. Ainsi, le Québec aurait des zones situées dans les trois premières catégories. Ces indices sont:
- la latitude
- la température moyenne en été
- la température annuelle moyenne
- les types de glace qui s’y trouvent
- les précipitations annuelles reçues
- le type de végétation qui y pousse
- l’accessibilité par voie terrestre ou maritime
- l’accessibilité par voie aérienne
- la population qui y vit
- le degré d’activité économique du lieu
Ce texte est paru dans le numéro 5, Nordicité, à l’automne 2016.
Plus de contenu pour vous nourrir