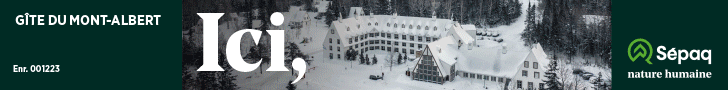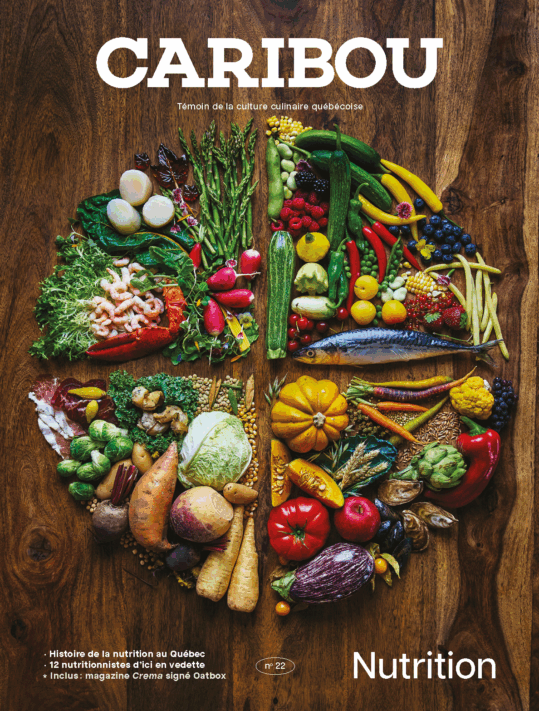On récolte ce que l’on sème
Publié le
11 février 2021
Texte de
Caroline Larocque-Allard
Photos de
Maude Chauvin

En 2009, Lyne Bellemare commande ses premières semences ancestrales dans le catalogue de l’organisme Semences du patrimoine: le haricot Beurre de Rocquencourt, qui poussait jadis dans les jardins québécois. Comme toutes les semences patrimoniales, celle-ci est à pollinisation libre, c’est-à-dire qu’on peut en conserver les graines d’une année à l’autre tout en préservant l’entièreté de ses précieux traits génétiques,contrairement aux semences hybrides qui envahissent les grandes surfaces.
Lyne met donc ses graines de haricot en terre dans sa parcelle de jardin communautaire, parmi ses semences achetées au Canadian Tire. «Cette année-là, une maladie a frappé le jardin, et tous les haricots sont morts, sauf mon Beurre de Rocquencourt. La moitié a survécu, et je me suis gavée jusqu’en octobre!» Son haricot patrimonial cachait donc dans son bagage génétique une résistance à la maladie qui allait décimer le jardin de quartier. En introduisant de la diversité dans son lot, Lyne s’était offert, sans le savoir, une certaine indépendance alimentaire.
Ce fut une révélation pour l’apprentie jardinière d’alors. Cette première variété, qu’elle pouvait resemer à l’infini, a fait germer en elle l’idée d’un potager dont la vocation serait de faire revivre des centaines de semences d’autrefois, riches d’un patrimoine génétique adapté à notre terroir. C’est ainsi qu’est né le jardin Terre Promise en 2014 à l’Île-Bizard, au nord-ouest de l’île de Montréal.
Un avenir sombre, semé d’hybrides
En ce qui concerne l’alimentation, notre avenir est intimement lié à la biodiversité… et au libre accès des communautés à cette diversité. Si nous détenons localement plusieurs variétés de différentes espèces et si nous sélectionnons les semences des meilleures plantes chaque année, nous nous assurerons d’avoir toujours quelque chose à manger, quoi que l’avenir nous réserve.
Or, depuis plus d’un demi-siècle, des semences hybrides à haut rendement ont accaparé le marché. Celles-ci sont obtenues industriellement, en croisant en laboratoire des plantes qui ne se seraient jamais hybridées en milieu naturel. Le problème, c’est qu’il est impossible de recueillir les graines issues de ces plantes hybrides pour les semer l’année suivante. Si un agriculteur s’y risquait, tous les traits des lignées végétales utilisées pour créer l’hybride ressortiraient aléatoirement, et la production deviendrait imprévisible.
Le marché s’est ainsi organisé autour de l’obligation, coûteuse pour les cultivateurs, de racheter chaque année toutes leurs semences, ce qui les a dépouillés peu à peu de leur autonomie par rapport à leur matière première. Les brevets associés aux hybrides leur interdiraient de toute façon de vendre les récoltes issues d’une réutilisation des semences.
Résultat: en repartant constamment de zéro, on ne permet pas à la plante d’évoluer en s’adaptant au climat changeant de son environnement. Notre sécurité alimentaire se trouve donc grandement fragilisée. En Amérique du Nord, 90% des cultivars de fruits et de légumes patrimoniaux ont disparu en un siècle. Par ailleurs, les 10 plus importantes compagnies semencières détiennent actuellement 75% du marché mondial de la semence.
«Étant donné l’abondance de produits alimentaires offerts dans les marchés, les gens ne se rendent pas compte des enjeux systémiques», explique Jane Rabinowicz, directrice de l’Initiative sur la sécurité des semences pour USC Canada. Cet organisme pancanadien basé à Ottawa lutte pour réintroduire de la diversité dans les champs et pour remettre l’autonomie des agriculteurs au cœur de notre système, afin de rendre aux communautés, pour l’avenir, la maîtrise de leurs ressources alimentaires.
«Le système actuel est basé sur la production à grande échelle d’un nombre limité de cultures, à l’intérieur desquelles on trouve peu de variétés, de même que sur la dépendance aux produits chimiques pour faire pousser ces plantes non adaptées, poursuit-elle. C’est un système précaire et peu viable, qui met en péril notre capacité à assurer localement notre autosuffisance en cas d’accélération des changements climatiques ou de rupture de l’approvisionnement en semences, lesquelles viennent majoritairement de l’étranger.»

Du pain sur la planche
Dans une parcelle des Fermes Longprés, aux Cèdres, en Montérégie, pousse un blé qui fait l’objet de toute la dévotion d’un agriculteur bien particulier. Celui-ci est convaincu que l’avenir de notre alimentation est étroitement lié à l’indépendance des producteurs.
Loïc Dewavrin participe à un programme d’USC Canada qui met en lien des chercheurs et des producteurs bios pour sélectionner des variétés de céréales à pollinisation libre convenant aux besoins de leur ferme. De tels projets de recherche participative concernent aussi la production potagère. Des dizaines de maraîchers au Québec testent des variétés prometteuses de carottes, de poivrons et de poireaux à pollinisation libre dont ils pourront conserver les semences.
«J’ai reçu cinquante grammes de semences de trois variétés de blé, raconte Loïc Dewavrin. Pendant quatre ans, je les ai améliorées en sélectionnant les plus savoureuses et les plus performantes. Maintenant, je multiplie les semences pour parvenir aux 40 tonnes annuelles dont j’ai besoin pour resemer et pour fournir notre moulin à farine de boulangerie. Cette variété finale m’appartiendra, et je pourrai la baptiser!»
Quand les trois frères Dewavrin ont transformé la ferme familiale en ferme bio, la souveraineté alimentaire était au centre de leurs préoccupations.
Très peu d’agriculteurs de grande échelle comme Loïc Dewavrin se lancent dans l’aventure, cependant. Celui-ci explique: «Un agriculteur québécois qui conserve ses semences n’est pas admissible à l’assurance récolte», qui offre des compensations financières quand la grêle ou les grands vents, par exemple, mettent en péril la production. «De plus, sélectionner une partie de son grain est un travail méthodique très demandant pour un seul fermier. Ici, on a l’avantage d’être trois familles qui se partagent les tâches.»
La Coop Agrobio, cofondée par Loïc Dewavrin, envisage d’ailleurs d’unir les forces et les ressources de ses membres pour rendre ce genre d’entreprise profitable. «La coopérative pourrait devenir dépositaire des grains que les membres développent afin de les rendre accessibles aux autres membres. Ainsi, pas besoin de tout faire soi-même, et on garde la structure à l’échelle régionale.» USC Canada explore de son côté des façons d’identifier clairement les semences produites au Québec pour aider les entrepreneurs à faire le poids sur le marché des semences importées.
Les trésors d’hier pour un avenir plus riche
Plusieurs producteurs sont donc déjà en mode solution. Les consommateurs, quant à eux, ont l’intuition, à tout le moins, que quelque chose ne va pas, croit Jane Rabinowicz, d’USC Canada.
«Tout le monde raconte l’histoire de la fraise de son enfance, du goût de la tomate qui n’est plus le même, des fameux pois que sa grand-mère faisait pousser dans son jardin, explique Jane Rabinowicz. Les gens remarquent que quelque chose s’est perdu, même s’ils ne savent pas nécessairement où ni pourquoi. Tant mieux, parce que si le consommateur n’embarque pas en encourageant les produits issus des semences développées localement, rien ne changera.»
À l’Île-Bizard, le seul hectare qui compose le potager de Terre Promise fournit en semences de plus en plus de jardiniers amateurs qui s’approvisionnent en ligne, mais il est difficile d’en produire suffisamment pour combler les besoins des maraîchers. Quelques-uns achètent une variété pour un marché de niche, explique Lyne Bellemare, mais les agriculteurs s’en remettent souvent à la prévisibilité des hybrides pour s’assurer un revenu. «Les semences à pollinisation libre ont une variabilité naturelle qui n’est pas souhaitée dans notre monde standardisé, mais cette adaptabilité est la clé de voûte d’un système alimentaire résilient. Parce que si le système semencier mondial s’effondrait ou si les hybrides de laboratoire ne poussaient plus dans nos écosystèmes changeants, qu’est-ce qu’on ferait?»
Les semenciers québécois s’affairent donc à dénicher ou à créer des variétés résistantes qui plairont aux consommateurs, en quantité suffisante pour que le marché puisse s’épanouir au-delà des niches actuelles et pour que les générations futures puissent s’affranchir des semenciers étrangers.
«On a beau triper sur les variétés d’antan, plusieurs ne conviennent plus à la demande», explique Michel Richard, semencier artisanal à Saint-Denis, en Montérégie, et véritable encyclopédie de notre savoir perdu. «Par exemple, les tomates ancestrales ont la peau très mince, contrairement aux tomates coriaces créées pour la grande distribution. Dans un marché qui préfère la beauté et le petit, un maraîcher ne cultiverait peut-être plus certaines betteraves des catalogues du siècle dernier, qui se nommaient Mammouth ou Léviathan!» commente-t-il, amusé. «Pourtant, garder vivante cette banque génétique est indispensable à notre sécurité alimentaire. Parmi la trentaine de céleris roses, blancs ou panachés qu’on trouvait à une autre époque, combien de traits génétiques nous serviraient aujourd’hui à réaliser des croisements plus résistants?»

Comme les semences qui ne germent plus après plusieurs années de dormance, le savoir qui se transmettait jadis disparaît aujourd’hui dans quelque jardin secret, déplore Michel Richard. «Quand nos aînés meurent avec leurs connaissances, c’est une bibliothèque qui brûle. Avant, ce savoir faisait partie de notre héritage: les jeunes filles partaient même de la maison paternelle avec toutes les semences familiales dans leur trousseau!»
Pour déterrer ces trésors, les semenciers d’aujourd’hui doivent donc fouiller chez leurs collègues, fréquenter les foires de semences, éplucher les banques nationales de gènes et lancer quelques bouteilles à la mer. «Avec ce que je trouve, je peux créer toutes sortes de croisements entre des plantes semblables, comme la nature aurait pu le faire. Parmi les résultats que j’obtiens, certains sont très bons, d’autres sont horribles!» plaisante Lyne Bellemare. «Il faut des années d’essais et d’erreurs, car peu d’information accompagne les semences, et elles n’ont plus été travaillées depuis longtemps.»
La semencière se fait toutefois un devoir de rattraper le temps perdu. «Imaginons ce qui serait arrivé si, pendant que les multinationales nous inondaient de leurs hybrides, on avait croisé et fait évoluer nos semences ancestrales dans nos terroirs respectifs… On aurait des super variétés aujourd’hui! Les semences du patrimoine de demain, ce sont aussi celles que moi et d’autres semenciers partout au Québec créons maintenant. Alors, il faut le faire, sans quoi nous nous en remettrons toujours à la grande industrie.»
Jane Rabinowicz rappelle qu’avec le miracle de la précision génétique, le travail n’est jamais terminé.
Elle constate que cette façon d’envisager l’avenir génère énormément de fierté chez les producteurs, qui peuvent désormais se dire: «Grâce à la graine que je sème aujourd’hui, les générations futures hériteront d’un riche et vaste patrimoine alimentaire, qui leur appartiendra.»
Plus de contenu pour vous nourrir