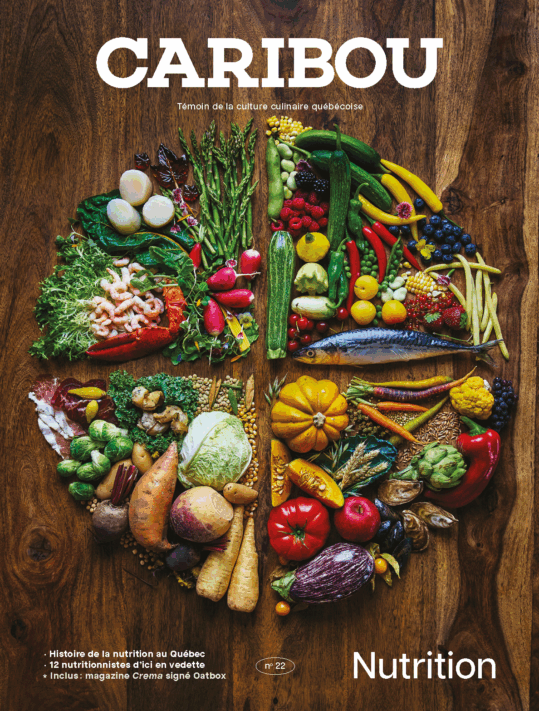Publié le
24 novembre 2025
Texte de
Caribou

La valeur des tables fermières a été reconnue au printemps 2025 grâce à plusieurs mentions dans le tout nouveau Guide MICHELIN Québec. Qui plus est, l’Espace Old Mill, une table fermière de Stanbridge East, a reçu l’une des trois Étoiles vertes attribuées par MICHELIN dans la province. Partout au Québec, on témoigne de carnets de réservations qui se remplissent en un clin d’œil. L’appétit des Québécois et Québécoises – ainsi que des touristes – pour les tables fermières est bien là.
Anne-Virginie Schmidt, cofondatrice des Miels d’Anicet, à Ferme-Neuve, dans les Laurentides, en sait quelque chose. «C’est beau un restaurant à la ferme, ça complète tellement bien une offre touristique, dit-elle. À la table, on peut expliquer aux clients où pousse le sarrasin que les abeilles ont butiné et qui est transformé dans la crêpe qui leur est servie. L’histoire qu’on raconte capte leur attention. Les gens veulent en savoir plus sur ce qui se retrouve dans leur assiette.»
Miels d’Anicet, avec sa Cantine Pollens & Nectars, figure parmi les premières entreprises à s’être lancées dans l’aventure de la table fermière au Québec. L’idée de ces pionniers des dernières décennies était d’attirer la clientèle à la ferme tout en mettant en valeur leurs propres produits. Une aventure qui comporte toutefois son lot de défis.
Entre deux mondes: agriculture et restauration
«Notre vocation première, l’été, c’est de faire du miel», souligne Anne-Virginie. La cofondatrice met le doigt sur la tension entre les réalités agricoles et les besoins de la restauration, qui sont bien différents. «On a décidé d’appeler notre établissement une “cantine”, parce qu’on avait une gêne à le nommer “restaurant”. On est des agriculteurs qui ont décidé d’ouvrir un restaurant.»
C’est aussi le cas de Sophie Gagnon, de la ferme Les Jardins de Sophie, à Saint-Fulgence, au Saguenay. Elle constate aussi que beaucoup de chefs, qui ne sont pas issus du milieu agricole, prennent désormais la clé des champs. «Ce n’est pas facile, le monde agricole. Nous, ça fait 24 ans qu’on est producteurs. Notre projet de restauration est arrivé après 15 ans d’expérience de culture de la terre», raconte-t-elle.
Sophie croit par ailleurs que son restaurant, qui accueille désormais des centaines de personnes par semaine sur la terre saguenéenne qu’elle a défrichée avec son conjoint, ouvre de nouveaux possibles. «Ça participe à accroître notre visibilité. Ça augmente l’achalandage à notre comptoir libre-service et le nombre de gens qui viennent nous voir au marché», affirme-t-elle.


Se rassembler pour trouver des solutions
Ces agriculteurs-restaurateurs portent plusieurs chapeaux: ils cultivent, transforment, cuisinent et accueillent à la fois. Cette polyvalence leur demande de définir leurs façons de gérer une entreprise à deux entités tout en conciliant la saisonnalité agricole et la réalité du service en salle.
Devant l’ampleur de la tâche se dresse La Table Ronde, un organisme qui rassemble les entrepreneurs en gastronomie et les chefs de file de la restauration québécoise. Le collectif a réuni au printemps 2025 les leaders du secteur afin d’unir leurs forces. Une rare occasion pour ces entrepreneurs et entrepreneuses d’échanger sur leurs réalités et de collaborer afin d’élaborer des pistes de solutions pour relever les différents défis qu’ils rencontrent.
L’initiative a attiré des entreprises d’aussi loin que du Saguenay (Le Saint-Sapin) et de Charlevoix (Faux Bergers) à la table fermière Les Mal-Aimés, située à Cookshire-Eaton, dans les Cantons-de-l’Est, avec d’autres propriétaires de tables fermières de l’Estrie (Parcelles, Espace Old Mill), de la Montérégie (Bika Ferme & Cuisine), de Chaudière-Appalaches (Domaine ARVI) et des Laurentides (Cantine Pollens & Nectars).
À l’invitation de La Table Ronde, ce nouveau regroupement, appelé Club Codév Restaurant à la Ferme, veut favoriser l’entraide et faciliter la reconnaissance du modèle des tables fermières, explique sa directrice générale, Debbie Zakaib.

Dès le premier tour de table de la rencontre qui s’est tenue dans une ambiance de partage, plusieurs enjeux communs sont apparus: trouver du personnel dans des régions où le logement se fait rare, expliquer le modèle d’affaires à des partenaires et aux instances réglementaires qui découvrent les besoins du secteur, convaincre des distributeurs alimentaires de desservir des rangs reculés, ou encore composer avec les aléas de la météo.
Partager ces défis entre pairs permet déjà de briser l’isolement. «Ça m’a rassurée d’entendre que d’autres vivaient la même chose que nous, témoigne Sophie Gagnon. Quand j’ai entendu Dominic Labelle expliquer comment il optimise ses trajets pour s’approvisionner, je me suis dit: “On n’est pas seuls!”»
Dominic Labelle, propriétaire de Parcelles, à Austin, incarne cette nouvelle génération de propriétaires de tables fermières. Formé dans les grandes cuisines montréalaises, titulaire d’un baccalauréat en agronomie et héritier d’une terre familiale, il semblait avoir toutes les cartes en main pour un parcours sans heurt. Pourtant, il vit lui aussi les mêmes réalités que ses comparses.
«Avoir un restaurant et une ferme requiert une quantité incroyable de travail qui doit se faire en même temps, dit-il. On a déjà perdu des cultures, pas parce qu’on ne savait pas quoi faire pour les sauver, mais juste parce qu’on n’avait pas le temps de s’en occuper!»

Un avenir à construire ensemble
Pour ces entrepreneurs, un arrimage des règles et des cadres est nécessaire. Anne-Virginie Schmidt résume: «On a tous envie de suivre les règles, mais parfois elles ne correspondent pas encore à notre réalité hybride.»
C’est pourquoi La Table Ronde souhaite inviter les différents paliers de gouvernement et instances réglementaires aux prochaines discussions, pour coconstruire les solutions. «Nous croyons que c’est en travaillant ensemble – producteurs, restaurateurs, gouvernements et partenaires – que ce secteur florissant pourra se développer et générer encore plus de retombées positives pour le Québec», souligne Debbie Zakaib.
Une vision qui réjouit Anne-Virginie Schmidt: «Cette expérience a tellement de sens. On met nos forces en commun, on brise l’isolement et on cherche ensemble des solutions.»
Une valeur culturelle et éducative
En attendant le développement de nouvelles réglementations, Dominic Labelle continue de croire à l’importance des tables fermières. «Il y a une valeur éducative à se retrouver au milieu des planches de légumes, souligne-t-il. Les gens ne savent pas toujours comment ça pousse, un brocoli. Chez nous, ils le voient, ils en goûtent un fraîchement cueilli, et ils découvrent un goût unique qu’on ne retrouve pas ailleurs!»
En reconnectant la population urbaine à la terre, ces initiatives de tables fermières qui fleurissent partout dans la province offrent une expérience culturelle, gustative et éducative incomparable, ce qui permet d’enrichir et de définir la culture culinaire québécoise de demain.
À propos de La Table Ronde et du Club Codév Restaurant à la Ferme
La Table Ronde est le Collectif de la gastronomie québécoise. Officiellement reconnue par le gouvernement du Québec comme organisme sectoriel, elle rassemble plus de 200 restaurants gastronomiques indépendants répartis dans 12 régions administratives de la province. Sa mission: développer la gastronomie comme moteur économique, culturel et touristique pour le Québec.
Le Club Codév Restaurant à la Ferme, lancé par La Table Ronde, vise à soutenir les entrepreneur·ses qui conjuguent agriculture et restauration. En favorisant l’entraide, le codéveloppement et la reconnaissance de ce modèle unique, il contribue à structurer ce mouvement émergent et à renforcer son impact sur les territoires, les communautés et la vitalité économique du Québec.
Pour en savoir plusPlus de contenu pour vous nourrir