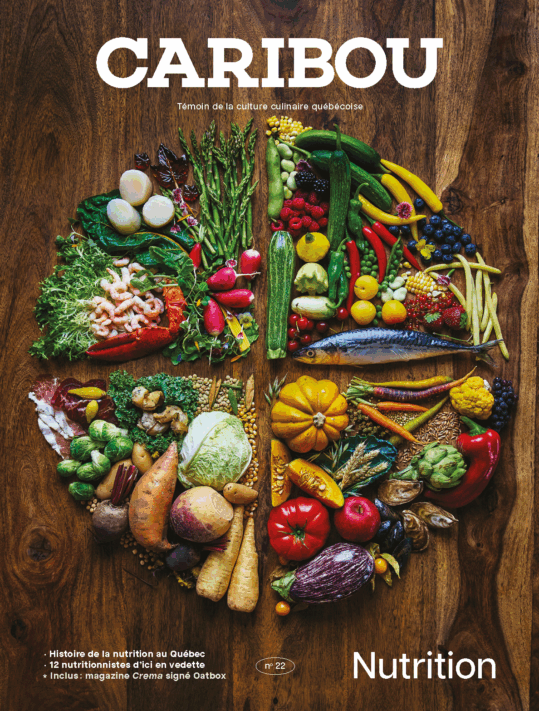Le grincement de dents de Kim Côté: «la forêt n’appartient pas aux entreprises forestières»
Publié le
16 octobre 2025
Texte de
Sophie Mediavilla-Rivard
Mention photo
Kim Côté

— Qu’est-ce que tu as pensé du projet de loi 97, qui promettait une réforme forestière avant d’être abandonné?
Je n’en revenais pas. Ce plan, c’était un recul de 30 ans! Le gouvernement donnait plus de 30% de la forêt publique à l’industrie. C’est immense… Et ce sans aucune considération pour sa valeur nourricière et patrimoniale. Heureusement que les autochtones se sont levés, parce que sinon ce serait passé. Je suis peut-être idéaliste, mais je pense que la foresterie ne se fait pas de la bonne façon au Québec.
— Selon toi, ce serait quoi «la bonne façon»?
Je pense qu’il faut considérer la valeur «autre que le bois» qu’une forêt peut apporter. Je pense aussi qu’il faut considérer les territoires autochtones. Et pour ce qui est des territoires non autochtones, je pense que les municipalités devraient avoir un droit de regard sur les coupes en terres publiques. J’espère que le Québec va s’inspirer de modèles d’ailleurs. Je pense à certains pays scandinaves, entre autres, qui tout en respectant l’environnement, ont beaucoup plus de rendement.
— Quel est le rôle de la forêt dans ton quotidien et dans ton travail?
La forêt est ancrée en moi depuis que je suis petit. C’est là où je me ressource, c’est là où je puise mon inspiration pour créer les plats que je sers au resto. Que ce soit un animal que je chasse, un produit forestier que je récolte ou un champignon que je cueille, pour moi, c’est l’expression même de la pureté. Sans forêt, on ne mange pas!


— Que reproches-tu à l’industrie forestière?
Ce qui m’insurge et me frustre au plus haut point, ce sont les actions des compagnies forestières. Je ne suis pas contre la foresterie en soi, mais je trouve qu’elle a trop de pouvoir sur nos forêts. C’est une industrie qui défait la forêt, notamment par les chemins forestiers qu’ils érigent et qui restent là même après la fin de leurs opérations. Ça crée plein de problèmes: les tiques se développent, les feux de forêt sont plus fréquents, ça détruit toute la faune, la flore et l’hydrologie.
Finalement, la forêt publique, elle n’est pas si publique que ça. Elle appartient aux entreprises d’exploitation forestière et, nous, on n’a pas notre mot à dire. Le pire, c’est que cette industrie est subventionnée par nos impôts.
— Comment la situation s’est-elle détériorée depuis les dernières décennies?
Avant, les coupes étaient faites sur des plus petites parcelles de territoire et de façon pas mal moins intensive. Dans les deux dernières années, c’est pire que jamais dans le Bas-Saint-Laurent. Quand j’étais petit, il y avait tout le temps plein de petites bêtes dans le bois: des martres, des visons, des pékans… Aujourd’hui, quand je vais en forêt, je n’en vois plus jamais et c’est très rare que je voie des traces. Les animaux n’ont simplement plus d’habitat. J’étais justement à la chasse à l’orignal il y a quelques jours et j’ai été choqué de constater à quel point il fait chaud, comparativement à avant. Les bûchers [ndlr: territoires ayant été soumis à une coupe forestière] sont de vrais déserts: il n’y a pas d’ombre créée par les arbres et la terre est asséchée. C’est très néfaste pour les bêtes. En plus, la machinerie défait tellement le sol que plusieurs de mes spots de champignons ont été ravagés…
Avant, les entreprises forestières étaient principalement actives en hiver — la meilleure période de coupe. La qualité du bois est meilleure durant cette saison, puisqu’il est bien sec comme la sève n’est pas encore montée. Aujourd’hui, les compagnies forestières bûchent 11 mois par année, 24 heures sur 24. Ça doit être fait le plus rapidement possible, le plus efficacement possible.
— As-tu espoir que la situation s’améliore?
Pas vraiment… Au moins, le restaurant et certains projets sur lesquels je travaille, comme le Kamouraska Mycologique, incitent plus de gens à aller en forêt et leur font prendre conscience que ce qui se passe est catastrophique. J’aimerais qu’on soit davantage à se battre pour nos forêts.
Plus de contenu pour vous nourrir