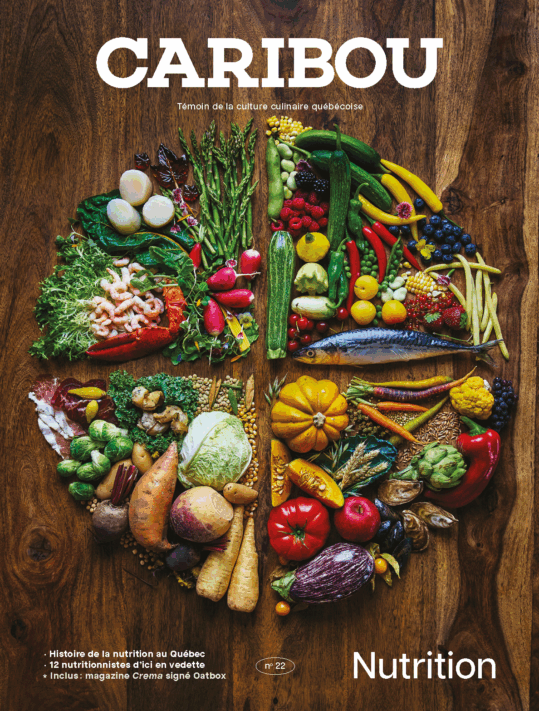Les femmes et la viande, une histoire d’amour-haine
Publié le
23 avril 2022
Texte de
Laura Shine

Bien des femmes avouent avoir hésité à commander un steak lors d’un premier rendez-vous galant, craignant d’effaroucher leur compagnon de table. Dans plusieurs sociétés, la consommation de viande par les femmes fait même l’objet de tabous précis – certaines parties, ou même certains animaux, leur sont carrément interdits, comme c’est le cas pour le gésier de poulet au Cameroun ou le bœuf en Eswatini, dont on dit qu’il rendrait les femmes plus intelligentes que leur mari. En temps de famine, c’est aussi aux hommes qu’elle est historiquement réservée, a fortiori en temps de rationnement pour cause de guerre: c’est alors au soldat, figure par excellence de la puissance masculine, qu’elle se destine en priorité. Dans presque toutes les cultures, et à toutes les époques, la consommation de viande révèle bien des choses sur les rapports de force entre les sexes.
La charge morale
La doctorante Alexia Renard, de l’Université de Montréal, s’intéresse aux adolescents véganes québécois. Plusieurs des participantes à son étude – les jeunes femmes représentent, jusqu’à maintenant, près des trois-quarts de l’échantillon – établissent, dès 15 ou 16 ans, un certain lien entre leurs choix alimentaires et leurs engagements féministes. Certaines citent «la manière dont les femelles animales peuvent être exploitées» en insistant notamment sur le sort des vaches laitières, rapidement privées de leurs veaux et destinées au rythme effréné de la production laitière industrielle. «Le lien [avec l’objectification des femmes] n’est pas toujours encore formellement articulé» par ces adolescentes, précise la chercheuse, mais celles-ci incluent d’instinct les femmes, comme les animaux, dans leur lutte pour une plus grande justice sociale.
Alexia Renard rappelle aussi que les femmes ont une longue histoire militante en ce qui concerne les droits des animaux: depuis la fin du 19e siècle, ce sont principalement elles qui mènent la charge, établissant des rapprochements entre l’asservissement des bêtes et celui des femmes, toutes deux infériorisées par le pouvoir patriarcal et soumises à ses «appétits» alimentaires comme sexuels.
Un aliment, mais aussi un travail
Si certaines s’en détachent complètement, d’autres, à l’inverse, s’engagent pleinement dans l’univers de la viande. Depuis une vingtaine d’années, Richard O’Reilly a vu changer l’ambiance dans les classes de boucherie qu’il enseigne au Centre de formation professionnelle Relais de la Lièvre-Seigneurie, à Buckingham, en Outaouais. «Il y a maintenant une ou deux femmes chaque année, dans une classe de 8 à 10 élèves. Elles sont très à l’aise, et elles ne font vraiment pas partie de la moyenne des femmes qui mangent moins de viande!» Elles n’hésitent pas à se tailler une place dans un milieu traditionnellement masculin, à leur manière. «Elles sont extrêmement bonnes, elles sont leaders. Elles sont beaucoup plus minutieuses que nos boys. Elles sont dans la finition, c’est bien ficelé, bien emballé, elles aiment le service à la clientèle aussi.» À une certaine époque, en plus des considérations culturelles et sociales, les exigences physiques du travail de boucherie en éloignaient plus d’une.
Des cultures, des pratiques
Enfin, la viande, c’est aussi un des aliments les plus fortement inscrits dans des pratiques culturelles traditionnelles. Francine Pelletier est copropriétaire de l’Auberge chez Denis à François, aux Îles de la Madeleine. À la carte de son restaurant gastronomique, une viande locale est toujours à l’honneur: le loup-marin, mieux connu sous le nom de phoque. «Je trouvais que c’était important de faire connaître cette viande-là. Les gens l’apprécient. C’est exotique aussi.» Elle a été l’une des premières à remettre la viande de phoque au goût du jour, dans les années 1980. Le Rendez-vous loup-marin, un festival qui célèbre chaque année l’importance de l’animal pour les Madelinots et Madeliniennes, a d’ailleurs souligné l’an dernier son rôle de pionnière.
Le phoque est une ressource abondante dans les Îles; les populations menacent même les stocks de morue, essentiels pour les pêcheurs de la région. La chasse est artisanale et locale, et l’animal est utilisé en entier, tant la viande que la graisse et la fourrure. Cuisiner cette viande riche et nourrissante a généralement été l’affaire de femmes, du moins dans la sphère domestique: «à la pêche, à l’abattoir, à la boucherie, ce sont des hommes. Mais ce sont les femmes qui préparent la viande à la maison», rappelle Francine Pelletier.
Paradoxalement, c’est aussi une femme qui a le plus nui à sa réputation: la croisade de Brigitte Bardot contre la chasse aux blanchons est encore bien ancrée dans les esprits, même si la pratique est interdite depuis 1987 (la chasse aux animaux adultes, elles, est très strictement règlementée). Signe de leur importance dans ces débats culturels et alimentaires, l’édition 2020 du Rendez-vous loup-marin, était consacrée à la place des femmes dans la culture, la gastronomie, la recherche ou encore la cinématographie autour du mammifère.
Honnie ou adorée, emblème de virilité ou encore de leadership au féminin, la viande est riche en connotations symboliques. Derrière le choix d’une bavette à l’échalote ou d’un pavé de foie ne se cachent pas seulement des préférences personnelles, mais bien un réseau complexe de représentations symboliques et de références culturelles. Un sujet à mijoter en attendant la saison du barbecue.
Plus de contenu pour vous nourrir