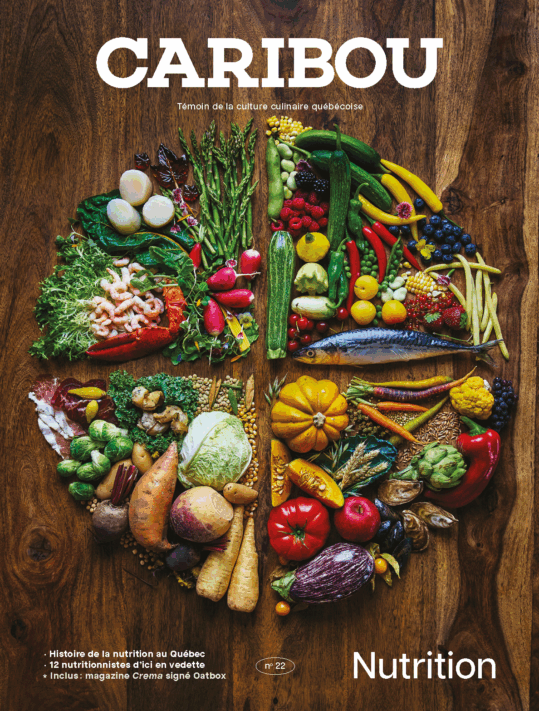Qu’est-ce qui fait rire la vache qui rit? (Introduction au carnisme)
Publié le
02 mars 2016

Pourquoi mange-t-on des porcs et des lapins, mais pas des chiens et des chats? Qu’est-ce qui détermine quels animaux nous jugeons comestibles? Petite introduction au carnisme, une idéologie qui se cache au coeur de nos assiettes.
Texte de Martin Gibert
Illustration de Sébastien Thibault
Imaginez que vous êtes reçu à souper chez des amis. C’est un vendredi soir d’automne. Comme il fait encore beau, on a mis la table sur la terrasse. On a sorti une belle nappe en vichy, un bouquet de fleurs, et la température du vin est idéale. Le maître de maison vous a concocté sa spécialité, un ragoût de boulettes. La viande, cuite à point, exhale un fumet délicat, et un savant mélange d’épices prolonge dans le palais chacune des tendres bouchées. Aucun doute là-dessus: c’est un des meilleurs ragoûts qu’il vous ait été donné de déguster durant votre vie.
Et puisque vous êtes poli, gourmand et pas mauvais cuisinier, vous vous enquérez de la recette. Quel est le secret de ce plat (ce n’est quand même pas du Ricardo)? À ces mots, le maître de maison, avec un léger sourire où perce la fierté, vous répond comme si de rien n’était: «Tout est dans le choix de la viande. J’ai remplacé le porc par du chien – par du golden retriever pour être précis.» On imagine le choc. La plupart des gens ressentiraient un profond malaise en entendant ces propos. Soudainement, les boulettes de viande perdraient leur attrait. Le ragoût ferait place au dégoût.
Cette petite expérience à faire en pensée, Melanie Joy, docteure en psychologie formée à Harvard, la propose souvent à ses auditeurs dans ses conférences. Depuis 2010, la psychologue américaine parcourt le monde pour exposer son idée qui se résume en un mot: le carnisme. Quant à la réalité que ce concept désigne, nous la connaissons tous – même si nous n’en sommes pas conscients.
Comme le remarque Melanie Joy, en un sens, rien n’a changé dans ce ragoût. C’est bien la même viande, le même fumet délicat, la même saveur épicée. Alors qu’est-ce qui justifie notre réaction de dégoût? Ce qui a changé, suggère la psychologue, c’est notre perception: nous ne voyons plus la viande comme de la viande. Nous la voyons comme un animal et, qui plus est, comme un animal attachant. Voilà donc ce que révèle cette anecdote: avant d’être gustatif, notre rapport à la nourriture est psychologique. Or, il y a quelque chose de particulier avec les produits d’origine animale. L’expérience précédente ne fonctionnerait pas avec des légumes. Qui serait dégoûté d’apprendre que ce qu’on lui a présenté comme une purée d’oignon est en réalité une purée de poireau? Voilà donc la question qui a conduit Melanie Joy à publier en 2010 ce livre au titre évocateur, Why We Love Dogs, Eat Pigs and Wear Cows.
Le carnisme est la réponse à cette question. Le carnisme est cette idéologie qui détermine ce que nous jugeons comestible.
Melanie Joy est un des premiers penseurs à s’être intéressés à notre perception de la nourriture carnée (c’est-à-dire issue de la chair, carn en latin). Intellectuelle novatrice et militante circonspecte, elle est une des figures montantes d’un large mouvement humaniste et écolo qui prend au sérieux les conséquences de nos choix alimentaires. Pourtant, tout en dénonçant le carnisme, Melanie Joy évite de blâmer les carnistes, c’est-à-dire ceux qui consomment des produits animaux – elle répugne même à utiliser ce terme stigmatisant. En effet, comment faire des reproches à quelqu’un qui se comporte comme tout le monde? Car le coeur du problème est là: les carnistes sont parfaitement normaux.
Une idéologie invisible, violente et destructrice
Si nous mangeons des porcs et des lapins, mais pas des chiens et des chats, ce n’est pas parce que les uns sont moins intelligents ou moins sensibles que les autres; ce n’est pas non plus parce qu’ils seraient moins goûteux. Comme idéologie, le carnisme est profondément culturel: les Coréens consomment du chien, la plupart des Indiens ne pourraient pas manger de la vache, et plusieurs cultures mettent régulièrement du chat au menu. En fait, parmi les milliers d’espèces disponibles, chaque groupe humain en a sélectionné une douzaine – le plus souvent des herbivores – qu’il consomme de façon régulière.
Mais le carnisme ne nous conditionne pas seulement à voir les cochons et les lapins comme comestibles; il nous dit aussi qu’il est normal, naturel et nécessaire de les manger. Or, ce que démontre depuis l’Antiquité l’existence de personnes végétariennes et, depuis quelques dizaines d’années, l’émergence du mouvement végétalien, c’est que c’est absolument faux. Manger ou ne pas manger des produits animaux relève d’un choix. Le concept de carnisme permet donc d’établir une symétrie: tout comme le végétarien et le végétalien choisissent de ne pas consommer d’animaux, il faut comprendre que le carniste choisit d’en consommer. Comme toutes les idéologies, végétalisme et carnisme sont donc des ensembles de croyances et de valeurs qui déterminent des comportements – en l’occurrence des comportements alimentaires.
Les défenses du carnisme et le paradoxe de la viande
Il faut dire que le carnisme est habile. Il peut mettre en œuvre une foule de stratégies pour occulter la souffrance animale. Il fait par exemple des animaux de simples abstractions sans identité: ainsi, on ne mange pas un cochon, mais du cochon. Il dissocie : sous son cellophane et sur son coussinet absorbant, le blanc de poulet ne doit surtout pas évoquer l’oiseau mort. Quant aux émissions et aux livres de cuisine, mine de rien, ils font de la propagande: ils nous encouragent à ne pas regarder plus loin que notre plaisir gustatif. Parfois, le carnisme essaie même de nous convaincre que ce sont les animaux eux-mêmes qui désirent être mangés.
Pourquoi le poulet St-Hubert porte-t-il un nœud papillon? Parce qu’il va au restaurant (pour manger du poulet, pardi). Ce type de perversion publicitaire porte un nom: suicide food. Dans le genre, le restaurant montréalais Au pied de cochon a franchi le mur du son: sur une illustration qu’on trouve dans le livre consacré à l’institution de la rue Duluth, on peut voir un sympathique cochon… qui sert lui-même sa tête sur un plateau.
Depuis la parution du livre de Melanie Joy, plusieurs études sont venues préciser les mécanismes de l’idéologie carniste.
Ainsi, des chercheurs ont récemment mesuré les principales «stratégies de rationalisation» derrière notre consommation de viande, à savoir ce qu’on appelle les quatre N de la justification: consommer de la viande serait moralement acceptable parce que c’est Normal («j’ai été élevé comme ça»), Naturel («l’humain est carnivore»), Nécessaire («nous avons besoin de protéines animales») et délicieux (pour Nice).
Les chercheurs ont constaté que les personnes qui invoquent les quatre N sont habituellement moins motivées par des raisons morales dans leurs choix alimentaires, se sentent moins coupables d’ignorer le bien-être animal et témoignent plus souvent d’une attitude spéciste – la discrimination sur la base de l’espèce, par analogie avec le sexisme ou le racisme. Ces personnes ont aussi tendance à attribuer moins de capacités mentales aux animaux qu’elles consomment – bref, à les chosifier. Comment l’expliquer? Cela permet de rendre plus supportable ce qu’on nomme le paradoxe de la viande. Car tout est là: d’un côté, nous aimons les animaux, mais de l’autre, nous aimons aussi les manger.
Dans une autre étude, on a demandé à des participants d’évaluer les capacités mentales d’un mouton à partir d’une photo. Or, si tous voyaient la même image, tous ne lisaient pas la même légende. Pour un premier groupe, le mouton allait changer de pré et passer le reste de sa vie avec d’autres moutons. Pour un second groupe, il allait plutôt être envoyé à l’abattoir afin que sa viande soit bientôt vendue au supermarché. Alors que les végétariens et les végétaliens ne sont pas influencés par les légendes, les omnivores attribuent moins de capacités cognitives au mouton qui part à l’abattoir. Cela s’explique bien dans le cadre de la théorie de la dissonance cognitive. Notre esprit est en effet capable de modifier ses croyances afin de minimiser ses contradictions internes.
Ainsi, en «démentalisant» le mouton destiné à l’abattoir, l’omnivore se persuade que cette bête n’est pas un être sensible – et que sa consommation n’est donc pas moralement problématique.
Enfin, si l’idéologie du carnisme tient bon, c’est parce qu’elle est capable de s’adapter. Melanie Joy identifie même un néocarnisme qui cherche à remettre sur le droit chemin (c’est-à-dire celui qui mène aux comptoirs des boucheries) les personnes tentées par l’abandon des produits animaux. Selon un certain discours compassionnel, on peut tuer les animaux en les aimant. Au-delà de la contradiction dans les termes, la «viande heureuse» peut-elle fournir une vraie solution de rechange au carnisme? Rien n’est moins sûr. Il n’empêche; plusieurs cherchent à renouveler l’image de la viande. C’est la tendance neo-butcher, qui hésite un peu entre la virilité assumée – mais qui «respecte» l’animal – et le souci soi-disant écolo d’une viande bio et locale. C’est le boucher tatoué avec un t-shirt sympa. À ce détail près qu’il gagne sa vie en payant des gens pour tuer des êtres sensibles, il ressemble à votre copain hipster. Pourtant, comme le remarque Melanie Joy, si le néocarnisme témoigne bien d’un sursaut de conscience morale, ce n’est malheureusement pas beaucoup plus qu’un changement d’emballage.
Reste une question. Qu’est-ce qui fait tant rire la vache qui rit? Dans le monde enchanté du carnisme, cette icône publicitaire résume notre complaisance. Car dans la réalité des élevages et dans les cris des chaînes d’abattage, il n’y a pas vraiment de quoi rire. Mais c’est tout le travail du carnisme que de nous faire oublier cette souffrance. Dans le monde inversé du carnisme, le vrai devient, pendant un moment, du faux: les tueurs sont sympas, et les veaux désirent être mangés. C’est pourquoi, avec ses boucles d’oreilles qui pendent à l’infini, la vache qui rit symbolise parfaitement notre aveuglement. Et devant notre crédulité sans limite, comment pourrait-elle faire autrement que se moquer de nous?
Martin Gibert est docteur en philosophie. Il a publié au en mai 2015 Voir son steak comme un animal mort: véganisme et psychologie morale (Lux Éditeur). Cet article est paru initialement dans le numéro 3, Tabous, en octobre 2015.
Martin Gibert est docteur en philosophie. Il a publié au en mai 2015 Voir son steak comme un animal mort: véganisme et psychologie morale (Lux Éditeur). Cet article est paru initialement dans le numéro 3, Tabous, en octobre 2015.
Plus de contenu pour vous nourrir