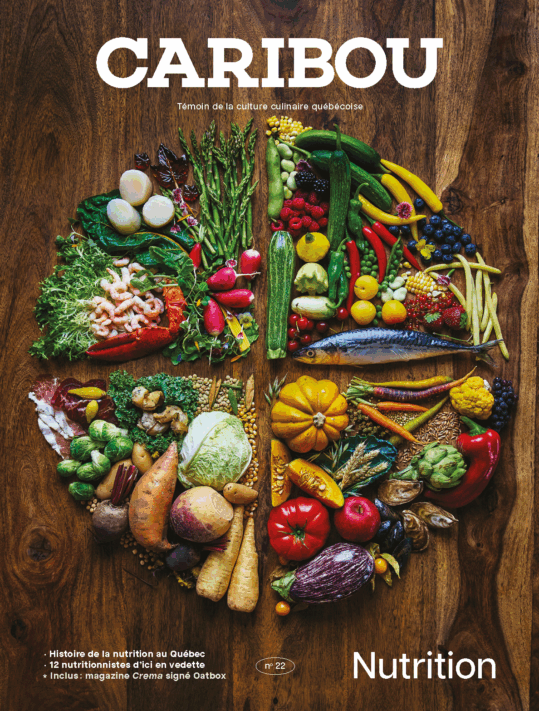Isabelle Lafont, l’avocate devenue vigneronne
Publié le
16 avril 2025
Texte de
Sébastien Daoust

Sur la route 112, en ce jeudi matin de mars, je passe à Rougemont et croise le chemin de la Petite Caroline. J’y ai travaillé pendant quatre ans, avant de m’embarquer à temps plein dans mon vignoble. Et continuant ma route, en direction de Saint-Césaire, j’essaie de me rappeler la dernière fois que je suis passé dans cette petite ville de la Montérégie. Et ça me frappe: c’était en septembre 2017. Il y a plus de sept ans maintenant.
Comme l’ironie ne danse jamais seule, je continue mon chemin vers Saint-Paul-d’Abbotsford, où Isabelle Lafont, maître de chai au vignoble Les Artisans du Terroir, m’a donné rendez-vous. Je parle d’ironie, car elle aussi, tout comme moi, a eu ce choix à faire entre une vie professionnelle à Montréal et travailler dans un vignoble.
Comme bien des villages au Québec, la vie de Saint-Paul-d’Abbotsford se concentre entre l’école, l’église, le parc, et le resto du village. C’est là, au Resto Le Friton, qu’Isabelle m’a donné rendez-vous.
Pourquoi ce resto?
«Parce que c’était anciennement la cantine du village. J’ai grandi à Saint-Paul. L’école à côté, c’était mon école, et on y voit les vergers, ici, en arrière. C’est Saint-Paul!» Elle se rappelle des vendredis, à la petite école, où riche de quelques dollars que ses parents lui avaient donnés, elle s’achetait deux «toastés tout garnis». La cantine était détenue par Patricia et c’est aujourd’hui sa fille, Mylène, qui l’opère. «On est dans les mêmes âges.»
Ça peut paraître anodin mais, pour comprendre Isabelle, il faut comprendre que Saint-Paul vit en elle depuis toujours. Ayant grandie dans les pommes, les cultures maraîchères et hydroponiques, elle se rappelle que son terrain de jeu était les champs, la forêt à quelques pas de la maison, et les serres.
Alors, pourquoi la petite fille de Saint-Paul décide, à la fin du cégep, de devenir avocate?
«J’avais de l’intérêt pour beaucoup de choses, j’hésitais entre le milieu des affaires et le droit, et il y avait cette idée que le droit menait à tout.» Studieuse, elle décide de faire ses études complètes, incluant le barreau.
Et la ferme familiale? «La question de la relève ne se posait pas à l’époque, mes parents et mon frère étaient bien en selle. L’entreprise était plus petite, et je ne voyais pas vraiment l’apport que je pouvais y amener.» Le droit lui permettrait de toucher un peu à tout, la formation ne serait jamais perdue. Elle navigue donc dans le domaine juridique, se retrouve à Montréal, en litige civil et commercial. Elle devient même associée et, à 35 ans, le chemin de sa carrière se dessine aussi droit qu’une autoroute. Quoi demander de plus?
Mais, elle garde toujours un œil sur ce qui se passe à Saint-Paul. «L’entreprise de mes parents a évolué et a grandi avec les années. Les choses se sont complexifiées aussi, avec l’arrivée des travailleurs étrangers temporaires, la croissance des opérations, l’achat de nouveaux équipements, le développement commercial. La question d’y revenir se présente, et je réfléchis à ça.»
Choix déchirant?
Elle regarde dans sa tasse de café et répond rapidement: «oui, parce que j’avais travaillé fort pour me rendre où j’étais en droit. J’avais commencé à faire du développement, j’avais gagné en expérience et je récoltais les fruits de ces démarches-là. Mais, l’idée que la ferme familiale passe à d’autres intérêts était impossible dans ma tête. […] J’ai réalisé que j’avais ce lien-là avec la terre, avec la campagne.» Il y a aussi cette volonté de rapprochement avec la famille, et un principe d’autonomie alimentaire pour le Québec, que les terres d’ici appartiennent à des gens d’ici. On sent dans ses propos et son sourire le besoin de rester ancrée à Saint-Paul, à sa famille.

Le brouhaha du café atteint notre table. Ce petit endroit très tranquille à notre arrivée est soudainement en pleine effervescence. J’ai peur, pour un instant, que mon petit enregistreur soit subjugué des voix avoisinantes. Ce serait bien dommage, car on arrive à la question qui m’intrigue toujours: où était Isabelle quand elle a décidé de changer de carrière?
«À Sutton, à la fin de l’été 2018. J’avais une grosse année au bureau. Fatiguée, je n’avais pas eu le temps de booker quoi que ce soit pour les vacances, et je n’avais pas le goût d’aller très loin. Un ami avait un chalet à Sutton, il me l’a passé pour une semaine. J’ai tout remis dans la balance.»
Je ne sens pas que le choix était si déchirant. Ses mots me donnent même l’impression d’une décision cartésienne. Les plus, les moins. Et le choix se fait de lui-même. La décision prise, elle prend quelques mois pour transférer ses dossiers, quitter Montréal, et elle entame donc, au printemps 2019, sa nouvelle vie. À Saint-Paul-d’Abbotsford, bien sûr.
La famille Lafont (Les Vergers St-Paul – vous en connaissez peut-être les pommes en épicerie sous le nom «Les Croquantes») accueille donc Isabelle. Soucieuse d’avoir son apport, elle découvre rapidement qu’elle a du temps pour faire autres choses. Cet «autre chose», elle le trouve chez les voisins, la famille Guertin. David Guertin, ami du frère d’Isabelle et propriétaire du vignoble Les Artisans du Terroir, loue quelques parcelles de terrain à la famille Lafont. Ces parcelles, plus arides, sont idéales pour la vigne. Le vignoble loue aussi une partie de l’entrepôt de la famille Lafont, sur la route 112, pour y établir son chai principal – celui en-dessous de la petite boutique du rang de la Montagne étant rendu trop à l’étroit avec la croissance du vignoble.

Isabelle commence d’abord par accompagner David Guertin dans ses visites avec des clients et en SAQ. Mais rapidement, elle veut se mettre «les mains dedans».
«Il y a des codes dans le domaine du vin, du vocabulaire et, comme dans tout, pour en parler de façon intelligente, je me rends compte que je dois comprendre comment ça se fait.» Elle commence donc à faire la taille des vignes, puis s’adonne aux différentes étapes de la culture de la vigne: l’épamprage, le rognage, l’effeuillage jusqu’aux vendanges. À l’automne, elle rejoint le père de David, Réjean, dans le chai. Elle suit les consignes de «Monsieur Guertin», un homme qui lui transmet sa passion pour le vin avec générosité et ouverture.
Elle aime le travail physique que ça demande. Les odeurs, les goûts. Le côté créatif aussi. Tous ses sens sont sollicités. Même si les produits sont déjà établis, chaque millésime représente un défi différent. Après deux millésimes, Réjean Guertin sent qu’il a la bonne personne pour prendre la relève dans le chai, et Isabelle se met à voler de ses propres ailes à l’automne 2021.
S’ennuie-t-elle du droit? «Des collègues, surtout, avec qui je m’entendais vraiment bien, et que je visite de temps à autre lorsque je fais des livraisons sur Montréal.» Mais pas tant pour le reste. En blague, je lui mentionne: «Le salaire?». Ça ne semble pas lui avoir effleuré l’esprit, elle semble surprise, pour finalement superposer ça avec le mode de vie qu’imposait la carrière d’avocate.
Je lui demande si son expérience en droit lui sert dans sa nouvelle vie: «Quand tu as un dossier de litige, tu dois comprendre rapidement les gens, leur réalité, leur industrie pour bien les représenter. Il faut être capable d’absorber rapidement tous les concepts en jeu. Ça a été la même chose dans le chai.»
La serveuse du café profite d’une pause dans notre discussion pour venir remplir ma tasse de nouveau. Par la fenêtre, je vois le mont Yamaska et les longs rangs de pommiers qui en jonchent les flancs. Trois travailleurs profitent du redoux pour continuer la taille des pommiers. Ça taille un peu, ça parle beaucoup.
Où en sont rendus Les Artisans du Terroir?
Des gammes classiques «Daumeray» et «Prémices», Isabelle a senti le besoin d’explorer ce que son terroir pouvait donner. «J’ai décidé d’y mettre de ma couleur», dit-elle, en riant. Elle se sent assez confiante pour jouer avec ce que la nature lui donne. Le saint-éépin, notamment, se devait d’être valorisé autrement selon elle, idem avec le vidal et la petite-perle. Elle développe donc ce qu’elle appelle ses «cuvées spontanées», qu’elle limite à des cuves de 2000 litres, avec des noms comme « a Bronzette», «Le Carré de Blanc», «Les Ondées», «Les Comparses» et «Les P’tits Tannants». Ce sont des cuvées d’inspiration, qu’elle peut décider de ne plus refaire, selon le millésime.
D’ailleurs, qui sont les p’tits tannants? Juste à lui poser la question, et à voir son regard, on devine qu’ils lui en font voir de toutes les couleurs. «Ce sont mes neveux, les trois petits « monstres » de mon frère: ils ont l’énergie de leur âge, testent un paquet d’affaires, dit-elle affectueusement. Et, quand j’ai goûté la première fois le vin qui porte en quelque sorte leur nom, je trouvais que ça me ramenait à l’enfance. Pas que je buvais du vin quand j’étais jeune, dit-elle en riant, mais c’était très juteux comme vin, ça me faisait sourire et ça me rendait tannante comme eux.»
Après six vinifications, elle considère qu’elle a encore beaucoup à explorer. Sa liste des choses à essayer augmente, elle ne diminue pas. Elle pense s’assagir un jour à ce niveau, mais pas pour l’instant. Par contre, elle ne voit pas le besoin de planter d’autres vignes, d’explorer d’autres cépages. «J’ai déjà beaucoup de couleur pour peindre, je n’en ai pas besoin d’autres!»

Parmi les vignerons au Québec, Isabelle est connue pour prendre la défense des cépages hybrides. Est-ce une déformation professionnelle d’ancienne avocate? «Non. Ça m’a frappé lors de mon premier congrès Cidres et Vins[1] en 2019. Comme consommatrice de vin, je ne m’étais jamais posé la question à savoir si des cépages étaient plus nobles que d’autres. J’avais du plaisir à boire et découvrir tous les cépages. Mais, quand je suis entrée dans la salle de conférence à cette époque, j’ai senti une dualité «vinifera versus hybride» – avec le nom cépage «noble» pour ces premiers, ce qui me semblait péjoratif pour les hybrides. Les hybrides représentaient – et représentent encore – pourtant plus du trois quart de l’encépagement québécois! Je ne crois pas qu’on doive mettre les deux familles de cépages en opposition. Il faut plutôt les mettre en valeur dans notre terroir québécois.»
Et, dans sa boule de cristal, que voit-elle pour l’avenir de l’industrie? Isabelle hésite, en regardant sa tasse de latté terminé depuis plus d’une heure. Isabelle est factuelle, lui demander d’être futurologue est peut-être exagéré. Mais elle finit par s’y attaquer. «Les vins ont fait un énorme bond qualitatif. Et, comme le mentionne Charles-Henri [De Coussergue, de l’Orpailleur], c’est en forgeant qu’on devient forgeron. Donc, techniquement, en continuant sur cette lignée, la qualité de nos vins va continuer de s’améliorer avec l’expérience. À un moment donné, on va aussi entrer dans une phase de maturité et un certain ménage va naturellement s’opérer: des assemblages phares vont se préciser, la culture de certains cépages plutôt que d’autres sera privilégiée au fur et à mesure des nouvelles plantations mais également de la rénovation des premières parcelles, et des directions plus claires vont se prendre dans le style des vins élaborés. On assiste également à une transition de vignerons de première génération vers la relève ou vers de nouveaux vignerons. Et, eux aussi ont déjà commencé à façonner cet avenir.»
A-t-elle encore un syndrome de l’imposteur? Dans une industrie ou tant de choses fonctionnent sur une base de réputation, comme fait-on pour se débrouiller? Y a-t-il un moment précis où elle a pu mettre ça de côté et apprécier pleinement son talent? «J’ai encore le syndrome de l’imposteur, oui. Je ne sais pas si je vais m’en débarrasser un jour. Mais, quand je vois nos vins, à côté des tiens ou d’autres vignerons que j’aime bien, dans un article dans les médias, par exemple, je me dis que je ne dois pas faire si mal que ça!»
À la fin, travailler dans les cuves, est-ce un travail solitaire pour une femme qui a plaidé devant des juges à Montréal? «Je trouve que c’est un bel équilibre, j’apprécie cette solitude-là, d’être dans ma man-cave. Il reste que je m’occupe aussi de la commercialisation et des événements, alors je rencontre beaucoup de gens.»
Elle prend une pause, et analyse la question sous un autre angle. «Mais, il y a peut-être l’aspect de la profondeur des relations qui n’a pas rapport avec la vigne et le vin, mais plutôt avec le changement de carrière après la mi-trentaine. Quand on a été stagiaire avec des gens en début de carrière, on établit des liens profonds avec eux. Je n’ai pas encore développé ce type de relation-là avec des collègues vignerons, mais je pense que ça va venir avec le temps. Je n’ai pas de problème à travailler en solitaire, mais l’isolement, c’est différent. À Montréal, c’était très spontané. Un simple SMS, un courriel, et on se réunissant quelques minutes plus tard dans un café tout près du bureau. Ici, il faut planifier pour se rencontrer. J’essaie d’utiliser chaque petite opportunité qui se présente à moi pour voir mon monde – surtout quand je vais faire une dégustation à Montréal! C’est peut-être l’isolement le plus difficile finalement.»
Déjà 11h, nous avons dépassé ce qu’on avait planifié comme temps pour l’entrevue. Je dois avoir pris 8 cafés! Le dernier point d’Isabelle sur l’isolement me laisse songeur, je le trouve tellement pertinent dans tout ce qui est relatif à l’agriculture, et même, par extension, à l’entrepreneuriat. Je suppose que tout le monde le vit d’une façon différente. Mais tout le charme de cette rencontre avec Isabelle me porte à penser que dans son cas, elle aura tôt fait de trouver sa recette pour y remédier!
[1] Le congrès Cidres, vin et alcool d’ici est un événement annuel, qui a lieu au mois de mars, et qui regroupe les industries du vins, cidres et alcools de fruits. Sur deux jours, près d’une cinquantaine de conférences professionnelles y sont données, et c’est l’un des principaux événements réunissant tous les acteurs de l’industrie.
Plus de contenu pour vous nourrir