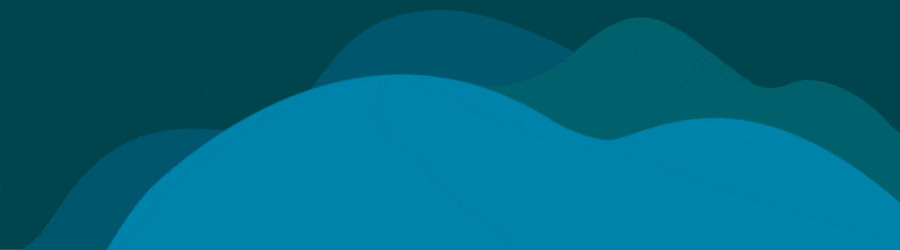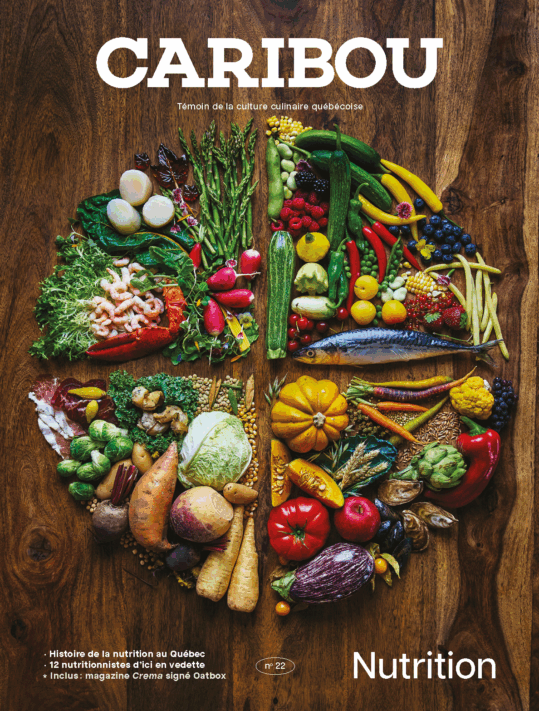Comment apprivoiser une bière sauvage
Publié le
26 novembre 2025
Texte de
Martin Thibault

Une réponse au vin nature?
Tout comme le terme «vin nature», la bière dite «sauvage» relève entre autres d’une tentative mi-pédagogique, mi-marketing, de communiquer un aspect particulier de la confection de la boisson. À la base, la fermentation sauvage d’une bière signifie que cette dernière contient des levures provenant de la nature. En d’autres mots, le moût de céréales n’a pas été fermenté avec des levures choisies par l’homme. Il a plutôt été fermenté par des levures contenues soit dans l’air environnant, soit sur le grain directement, ou même nichées dans les interstices d’une barrique de bois ou d’un pot de terre cuite. Les lambics de Belgique, les chichas du Pérou et les Umqombothi du sud de l’Afrique sont des bières de ce type.
Sources de débats dans l’univers du vin, les levures de type brettanomyces, responsables des profils aromatiques clivants, sont plus souvent qu’autrement harmonieuses avec les céréales et les aromates d’une bière. Alors on dit qu’elles ne dénaturent pas du tout le profil final du produit. De plus, la lenteur avec laquelle les brettanomyces se développent amène son lot d’avantages pour le dégustateur. La bière en question possède souvent un immense potentiel de vieillissement, contrairement à la majorité des styles de bière qui doivent être bus dans les mois qui suivent sa confection.
3 excellentes bières québécoises dites «sauvages»

Jardin Arthur Basilic, de Brett & Sauvage, en Gaspésie
Une bière d’une complexité inouïe gracieuseté de la microbrasserie gaspésienne. Cet assemblage de bière spontanée et de bière ensemencée de levures saccharomyces isolées sur du miel a ensuite macéré sur de la rhubarbe et du basilic, créant une bière aux parfums frais de verdure, munie d’une acidité vive et d’une bulle fine.

Saison Bee-Bop, de la Brouërie Sutton, en Estrie
La brasserie Sutton se spécialise en fermentations mixtes, alors la presque entièreté de leur portfolio pourrait être qualifiée de sauvage (100% brettanomyces) ou mi-sauvage (co-fermentation de saccharomyces et de brettanomyces). Leur particularité est que ces bretts sont responsables de la fermentation primaire et développent donc très peu des odeurs clivantes typiques aux fermentations secondaires avec ces types de levures. Leur Saison Bee-Bop, par exemple, est fruitée, herbacée et sèche, avec tout juste un soupçon de rusticité, parfait pour l’allier à un plateau de fromages variés.

Léa, de Robin – Bière Naturelle, à Waterloo
Le cocktail fermentaire que privilégie Robin contient de nombreuses levures et bactéries acidifiantes, toutes séjournant dans les barriques de chêne de leur chai. Une bière classique de leur portfolio afin de découvrir leur signature «nature» est la Léa. Elle est sèche et vive, avec des arômes fruités rappelant le citron, les fruits du verger avec une certaine rusticité boisée.
Accords mets et bières avec une bière sauvage
Les saveurs rustiques, presque poussiéreuses, des levures de type brettanomyces tendent à sévir dans des bières sèches équipées d’une prise de mousse naturelle. Dans ce contexte, de nombreux fromages seraient délectables, notamment des pâtes semi-fermes comme le Pied-de-Vent, des îles-de-la-Madeleine, ou le Alfred le Fermier, de la Fromagerie La Station, en Estrie. Cela dit, ce poulet rôti avec chou braisé pourrait fonctionner à merveille également, surtout si vous le garnissez généreusement de sauge, comme c’est indiqué dans la recette.
Plus de contenu pour vous nourrir