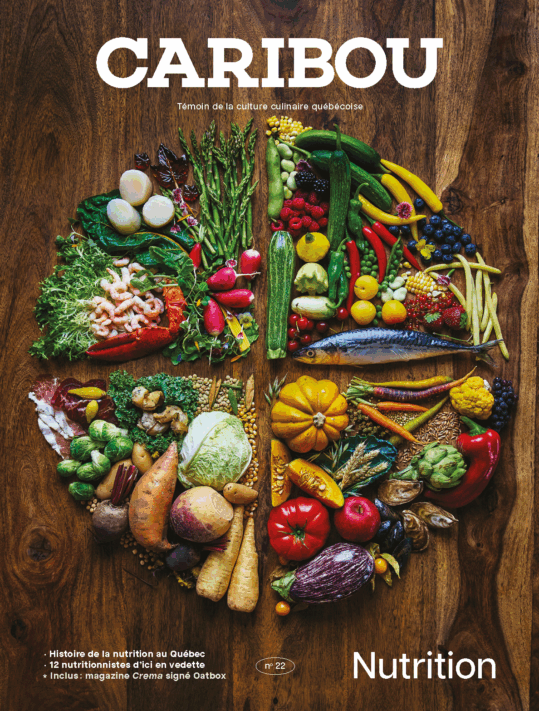Je ne suis pas né dans une barquette de styrofoam
Publié le
01 mars 2017

Nous sommes très loin du «goose break» des Cris de Mistassini ou de la manière de transmettre la technique familiale de fabrication de la sauce bolognaise des Forcada, mais il y a quelques habitudes que je n’ai pas perdues malgré un séjour de plusieurs années de l’autre côté du Parc. Les initiés comprendront ce rapport que nous entretenons avec cette parcelle de forêt d’épinettes entrecoupée d’un truck stop anciennement aussi crade que le pub dégueulasse où Ewan McGregor se submergeait la tête dans Trainspotting en 1996. Aujourd’hui rénové, il conserve malgré tout cette odeur de pisse incomparable collée à tout jamais dans ce passage obligé de la transhumance boréale, mais là je m’égare un peu.
Comme je le disais certaines choses sont restées inscrites à mon horaire malgré la distance et l’offre sociale, culturelle et institutionnelle de la «grande ville». Il faut dire que j’ai toujours voulu conserver une très grande proximité avec les métiers traditionnels, et je ne veux pas dire par là récupérer des symboles et des codes vestimentaires de certains corps de métiers comme les nouveaux bûcherons barbus du Plateau, mais bel et bien mettre la main à la pâte quand il est temps d’abattre la moitié de la fermette pour s’assurer de faire le ragoût, la saucisse et principalement le bacon de l’année à venir. Ce dont je veux vous parler ici c’est de l’importante place que devait prendre, il y a encore une ou deux générations, cet héritage et ces différents savoir-faire que demande une telle opération.
Il faut dire que j’ai conservé un côté étrange pour mes collègues de la capitale nationale lors de mon passage qui finalement aura duré six ans. Moi j’étais le type bizarre qui avait un congélateur dans la cuisine (appart étudiant oblige) qui entremêlait porc, agneau, lapin et peau de caribou tous éviscérés par moi-même. Ce n’était pas, et d’ailleurs ce ne l’est toujours pas aujourd’hui, par un manque de cœur pour c’te pauvre tit’bête là, mais bien par conscience que tout ça n’était pas venu au monde dans une barquette de styrofoam.
Néanmoins, l’impact de cette prise de conscience demeure pour moi d’une importance capitale dans mon équilibre quotidien. L’éducation de mes enfants passe aussi par cette prise de conscience collective de la provenance et de l’impact de notre alimentation sur l’environnement.
[gallery type="rectangular" size="medium" link="file" ids="1996,1988,1990,1989,1992,1991"]Arriver à produire une grande partie de son alimentation ne devrait pas être un effet de mode mais plutôt une nécessité. Toutefois, cette réflexion est bien belle mais comment en arriver à se rapprocher de notre gigot d’agneau ou de notre tranche de bacon sans penser au processus de transmission fondamentale des générations qui nous précèdent?
Chaque année, comme en témoigne le travail photographique et l’approche documentaire du photographe Philippe Boily, nous mettons en production l’élevage de quelques porcs pour les besoins de nos petites familles moderne. Cette approche, extrêmement créative de par sa simplicité et aussi de par l’aspect festif de ces journées de dur labeur de l’automne, ne serait pas aussi simple et exécutée avec une si magnifique précision sans la présence (omniprésence) du père, du beau-frère, de la belle-mère de mon frère, du bourrin, de mononc Girard et pis du maréchal-ferrant.
Ces journées sont un véritable mélange de transmission pure et dure d’un savoir-faire d’autrefois, de blagues salasses et d’un immense moment de réalité en ces temps de morosité dictés par des slogans politiques qui parlent soi-disant du vrai monde.
Juste le fait d’écrire ces lignes, j’ai mes sens qui s’éveillent et mes souvenirs, principalement olfactifs qui s’animent et défilent entre une odeur de fumoir et de bacon. Ce dont je vous parle ici c’est d’un héritage, un savoir-faire et une transmission d’un certain nombre de gestes précis et clairs comme de l’eau de roche, exécutés des milliers de fois avec une résonnance ancestrale.
Ils sont plus que nos pères, mères ou grands-pères, ils sont les détenteurs d’un savoir et d’une manière de vivre que les Steven Guilbeaut et les Laure Waridel de ce monde nous somment de suivre. Eux ne sont plus tellement conscients de cette richesse et ne nous tiennent absolument pas rigueur de ne pas les reproduire. Le plus beau dans tout ça c’est que, pour une approche de passation dans un Québec moderne, il ne s’agit pas d’actes aux caractères spirituels ou religieux, mais purement expérimentaux et techniques. Je ne désire pas entrer dans une analyse ethnographique de ces rapports sociaux et ces relations entre technique et culture ou entre matière et homme, mais rapporter mon ressenti sur ce contact de proximité avec ces hommes et ces femmes de terrain.
Moi, qui suis une bébitte naviguant entre urbanité et ruralité, entre technicité et technologie, je constate aujourd’hui avec un certain recul que j’analyse et j’entretiens avec ces actions une approche plus près du laboratoire de l’artisanat et de l’expérimentation, que d’une transmission des savoir-faire par imprégnation au regard d’un maître. Je suis en mesure de reproduire le geste et de le transmettre sans plus. Nous ne sommes donc pas au cœur d’une pratique ethnologique au sens classique du terme et les jeunes qui m’entourent sont eux aussi dans cette position. Cette vision d’intérêt pour la chose n’est certes pas l’affaire exclusive d’une jeunesse post-rurale, car il est possible de la retrouver au cœur même du New York actuel ou même dans le Montréal cool du Mile End. En effet, c’est au détour de certains quartiers urbains, ou encore de petits villages réinvestis, que l’on peut voir apparaître de petits ateliers de bois, de forge ou encore de néo-boucherie ou un resto cool qui produit lui-même son bacon derrière la boutique. Merci à Martin Picard et Hugues Dufour pour ce nouveau regard sur la bouffe dans le milieu de la restauration. Une ambigüité entre tradition et innovation que l’on trouve souvent sous l’appellation de DIY (Do It Yourself).
De tout cela, il demeure une chose qui ne m’appartient pas, c’est l’œil de celui qui regarde. Celui qui scrute parfois avec dégoût ou effroi une pratique somme toute assez violente. Mais il y aussi l’œil de celui qui désire comprendre et qui voit là la beauté du geste et de l’éphémère état de grâce qui nous habitent lors de ces journées de boucherie. C’est à travers cet œil que la transmission peut avoir lieu. C’est le travail de Phil Boily qui m’a fait voir la vraie nature de la transmission; ça ne sert à rien de chercher à comprendre à tout prix le sens des gestes, il faut à la base y voir la beauté sous-jacente pour désirer les reproduire. Bref, la transmission, c’est le contemplatif qui en a marre de trouver ça beau et qui veut se salir lui aussi les mains.
***
Ce texte est paru une première fois à l’automne 2014 dans le magazine Zone Occupée arts/culture/réflexions. En 2016, le réalisateur d’origine roumaine Bogdan Stefan réalise un court métrage documentaire produit par l’ONF sur notre famille et ses intérêts pour l’autonomie alimentaire et la transmission intergénérationnelle. Présenté en salle et en festival dans la dernière année, le court documentaire est pour un temps disponible sur Tou.tv dans le cadre des Rendez-vous du cinéma québécois. C’est dans ce contexte que l’équipe de Caribou vous propose une réédition de ce texte et un lien vers ce court métrage de l’ONF.Plus de contenu pour vous nourrir