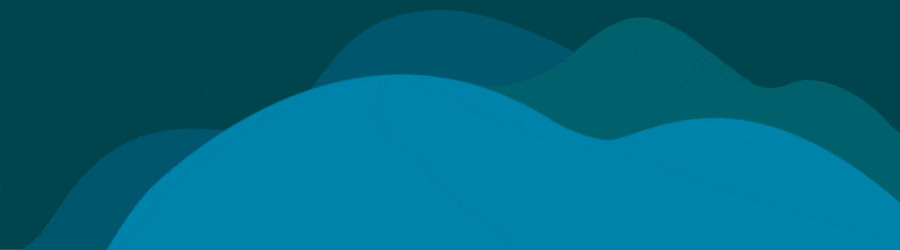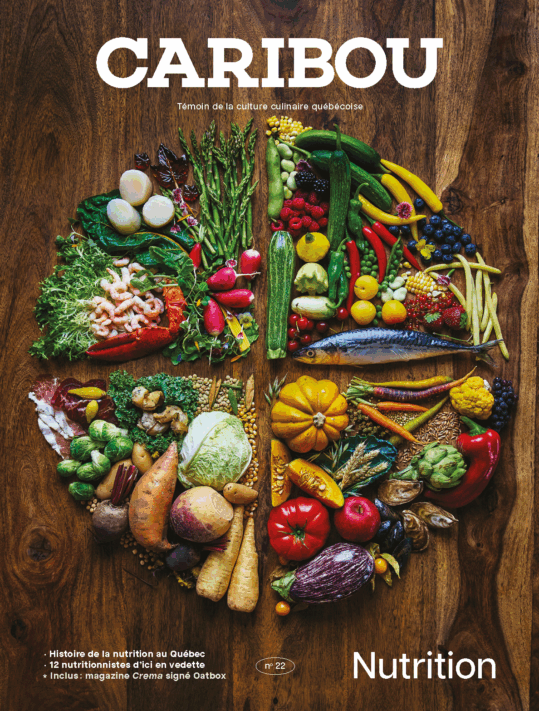Le secret du sirop d’érable anishnabe
Publié le
04 avril 2022
Texte de
Nicolas Lachapelle
Photos de
Nicolas Lachapelle

Cette initiative est celle de deux sœurs, les soeurs Jérôme. Marlène Jérôme a travaillé pendant de longues années comme gestionnaire pour l’industrie forestière. Il y a huit ans, fatiguée de la précarité du milieu, elle quitte son emploi et rejoint sa sœur, la cheffe Adrienne Jérôme, au conseil de bande de leur communauté. Ensemble, elles décident alors de réaliser le rêve de leur mère: rétablir la production de sirop d’érable dans la communauté.
Cette initiative n’est pas anodine. Pour les sœurs Jérôme, le sirop d’érable est une affaire de famille. Toutes petites, avec leur mère, elles prenaient déjà part au Cigonica, le temps des sucres en anishnabe.
«Notre kokom [grand-mère] a fait du sirop toute sa vie. Bien avant l’arrivée des chalumeaux et des chaudières en fer-blanc, elle faisait ça avec des paniers d’écorce et des chevilles de bois dans notre territoire familial», raconte Marlène Jérôme.
«Un jour, notre mère était nostalgique de cette époque. Elle a décidé d’aller trouver notre grand-mère pour qu’elle lui enseigne la confection du sirop. Après ça, elle a commencé à faire les sucres par elle-même», ajoute-t-elle.
La mère d’Adrienne et Marlène distribuait son sirop aux membres de la communauté, mais surtout aux enfants. «C’était sa manière à elle de faire vivre cette tradition et elle a fait ça jusqu’à sa mort», souligne avec Adrienne avec un sourire.
Il y a huit ans, quand Marlène est arrivée au conseil de bande, elle et sa sœur, en partenariat avec des acteurs du milieu éducatif, ont décidé d’institutionnaliser l’initiative de leur mère. Aujourd’hui, c’est Marlène qui, à titre de directrice des services d’éducation, supervise le projet.
 Les instigatrices du projet, les soeurs Marlène et Adrienne Jérôme.
Les instigatrices du projet, les soeurs Marlène et Adrienne Jérôme.  Joan Wabanonik est la coordonnatrice en activités culturelles pour l’école primaire de la communauté.
Joan Wabanonik est la coordonnatrice en activités culturelles pour l’école primaire de la communauté. Un havre de paix au cœur de la forêt
L’érablière, c’est Joan Wabanonik, la coordonnatrice en activités culturelles pour l’école primaire de la communauté, qui m’y emmène. Joan est toute petite et le semble encore davantage au volant de son pick-up Ford Ranger rouge. Cela ne l’empêche pourtant pas de déborder d’énergie. Sous sa tuque aux motifs traditionnels, ses yeux rieurs me dévisagent sans la moindre gêne. Nous roulons pendant une vingtaine de minutes à travers le parc de La Vérendrye. C’est là, sur le chemin, que Joan m’explique son attachement au projet d’érablière.
Joan a immédiatement su qu’elle devait s’impliquer dans le projet: «Je me sens chez nous à l’érablière, je m’y sens tellement bien, comme si ma grand-mère était là.»
Au kilomètre 434, Joan quitte l’autoroute 117 et bifurque sur une route forestière. Après un long moment dans la forêt, une clairière se dessine enfin. C’est là que nous attendent Nic Papatie et Benjamin Pouccachiche, deux travailleurs de l’érablière. Le périple n’est pas terminé, ils ont pour tâche de nous y conduire en motoneige.
Sur le chemin, Benjamin, 35 ans, m’explique qu’il en est à son premier temps des sucres à l’érablière. Il n’est ici que depuis une semaine, mais déjà il en ressent les effets bénéfiques: «Je ne vois pas les journées passer, ça m’aide d’être ici, ça m’aide à rester à distance de mes problèmes de consommation.» Sur le chemin, il me raconte avoir eu plusieurs démêlés avec la justice dans le passé. La dernière fois, en 2016, ses problèmes l’ont mené en prison. Depuis qu’il en est sorti, Benjamin tente de se reconstruire et d’avoir un effet plus positif dans sa communauté «pour que les plus jeunes ne tombent pas dans les mêmes pièges que moi». Après quelques kilomètres de plus dans la forêt avec pour seule trame sonore le moteur de la motoneige, Benjamin laisse échapper sans me regarder: «Ici, chaque jour est une leçon.»
Nous arrivons bientôt à l’érablière. Le site réunit trois petits bâtiments: une tente où se logent les travailleurs, un petit entrepôt pour le matériel acéricole et l’érablière elle-même formée d’une structure de rondins au toit de tôle et aux murs composés de bâches. Sous l’érablière, deux larges chaudrons noircis sont suspendus au-dessus d’un grand feu. Dans les chaudrons, un liquide doré cuit à gros bouillons et libère une fumée opaque et sucrée. Un homme dans la mi-trentaine s’affaire autour du feu. Cet homme, c’est Derall Jérôme, le neveu des soeurs Jérôme et le responsable de l’érablière, «et de ses 287 entailles», me précise-t-il avec fierté.

C’est sa cinquième année ici. À l’érablière, le travail est dur et physique. À la dernière saison, à force de soulever les lourds seaux d’eau d’érable, Derall a développé une hernie discale. Il a donc dû cesser toutes activités physiques pendant neuf longs mois. Au terme de sa convalescence, son docteur lui a déconseillé de retourner faire les sucres, mais en mars l’envie de retrouver la vie à l’érablière était trop pressante. «J’aime trop ça pour ne pas y retourner», me confie-t-il tout sourire.
Derall vit ici depuis deux semaines avec ses amis, Nic et Benjamin. Au début du mois de mars, ils ont procédé à l’entaillage des ananatik, érables en anishnabe. Depuis quelques jours, le temps se fait plus doux et l’ananatikabo, la sève, s’est mise à couler. Les trois comparses ont alors commencé la tournée des érables en raquette. Ils en reviennent les bras chargés de plusieurs seaux remplis du précieux liquide.
Le jour de ma visite coïncide avec la première cuisson de la sève. Penché au-dessus de ses grands chaudrons, l’œil vigilant, Derall est complètement absorbé par cette étape. Le sirop anishnabe est confectionné sans thermomètre. «Il faut être attentif pour faire du sirop à notre façon», souligne le sucrier en chef. «J’étends le liquide sur la neige. S’il cale, ce n’est pas encore bon. S’il flotte, c’est prêt!» Ce n’est pas une mince tâche, l’eau d’érable devra bouillir environ huit heures dans les grands chaudrons de fontes avant de devenir sirop.
Ces chaudrons au-dessus desquels s’affaire Derall, ce sont ceux de sa grand-mère, la mère de Marlène et d’Adrienne. Un détail peut-être, mais qui fait toute la différence pour le jeune homme: «Quand je fais les sucres, j’ai le sentiment de prendre soin de mon héritage.»
Depuis sa hernie, Derall travaille davantage à former la relève, laissant aux autres les activités les plus éreintantes. Il espère cependant faire les sucres aussi longtemps que possible, «tant que ma santé le permettra».
 Benjamin Pouachiche et Derall Jérôme entaillent les érables.
Benjamin Pouachiche et Derall Jérôme entaillent les érables.  L’eau d’érable est transportée à la main.
L’eau d’érable est transportée à la main. 
La relève
Dans la communauté située à l’extrémité nord du parc de La Vérendrye, les sucres commencent généralement entre la mi-mars et le début-avril et s’échelonnent sur environ quatre semaines. L’érablière emploie quatre personnes par jour. Certains jours de semaine, les quelque 600 étudiants des écoles secondaire et primaire de la communauté viennent aider Derall et ses comparses. Dans le cadre du programme de langue et culture offert par le service d’éducation de la communauté, ils prennent part à toutes les étapes de la confection du sirop: de l’entaillage à la course aux érables, de la réduction de la sève à la production de la tire et du sucre.
Chez eux aussi, les effets bénéfiques des sucres se font sentir. Dans son bureau, Marlène Jérôme pense à sa mère: «Elle serait fière de savoir que la tradition se poursuit auprès de nos enfants.»
«Il y trois ans, il y avait dans la communauté une jeune fille de 14 ou 15 ans avec des idées suicidaires. À l’automne, nous avons décidé de l’intégrer dans les activités de l’érablière. Quand je l’ai revu là-bas en avril, ce n’était plus la même jeune fille. Elle riait sans arrêt», se rappelle Marlène.
Cette jeune fille n’est pas la seule à profiter des bienfaits de l’érablière. Marlène évoque avec le sourire l’exemple de ces trois jeunes hommes qui sont si enthousiasmés par le projet qu’ils passent toutes leurs fins de semaine à l’érablière. Ils veulent reprendre le flambeau éventuellement.
«Quand les jeunes viennent visiter l’érablière, ils partent en courant sur le sentier devant les enseignants. Les enseignants capotent, ils pensent que les jeunes vont se perdre, mais les jeunes connaissent parfaitement le chemin», dit Adrienne.
 «Quand je fais les sucres, j’ai le sentiment de prendre soin de mon héritage», confie Derall Jérôme.
«Quand je fais les sucres, j’ai le sentiment de prendre soin de mon héritage», confie Derall Jérôme. Fêter le printemps
Bientôt, la saison des sucres arrivera à son terme. Le sirop produit ne sera pas vendu, mais partagé entre les membres de la communauté lors de parties de sucre. Ce sirop, le sirop anishnabe, se distingue du sirop allochtone par sa couleur, plus foncée, mais surtout par son goût particulièrement fumé. «Les Aînés en raffolent», me confie Derall en riant. «Certains n’ont pas le droit d’en manger à cause de leurs problèmes de santé, mais ils ne peuvent pas s’en empêcher», ajoute-t-il, espiègle.
Dans ces fêtes, le sirop est souvent consommé avec de la bannique, un pain traditionnel autochtone, du pain frit, des kibadci (l’équivalent de nos grands-pères dans le sirop) ou encore avec des viandes d’orignal ou de castor. Ici, à 50 kilomètres de la réserve, en pleine forêt, j’imagine les petits et les grands réunis autour de ces parties de sucre et le mot communauté prendre un tout autre sens.
Une tradition menacée par la déforestation
Aujourd’hui, les coupes forestières menacent cette tradition. Adrienne rapporte que plusieurs familles arrivent sur leur territoire au printemps et n’y trouvent plus d’érables. C’est un dossier sur lequel travaille la communauté, mais qui est difficile à faire avancer. «Nous voulons protéger le maximum de nos terres, mais année après année, le ministère donne la permission aux forestières de venir couper sur nos territoires», se désole-t-elle. Cette situation mène souvent à la confrontation. Heureusement, avec les années et les combats, la communauté de Lac Simon a acquis une réputation de redoutable chien de garde. De plus en plus, les compagnies forestières redoutent de se frotter à eux.
Plus de contenu pour vous nourrir