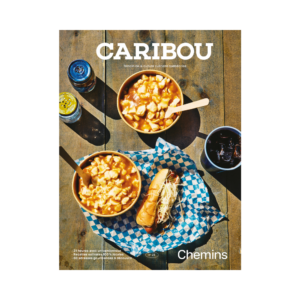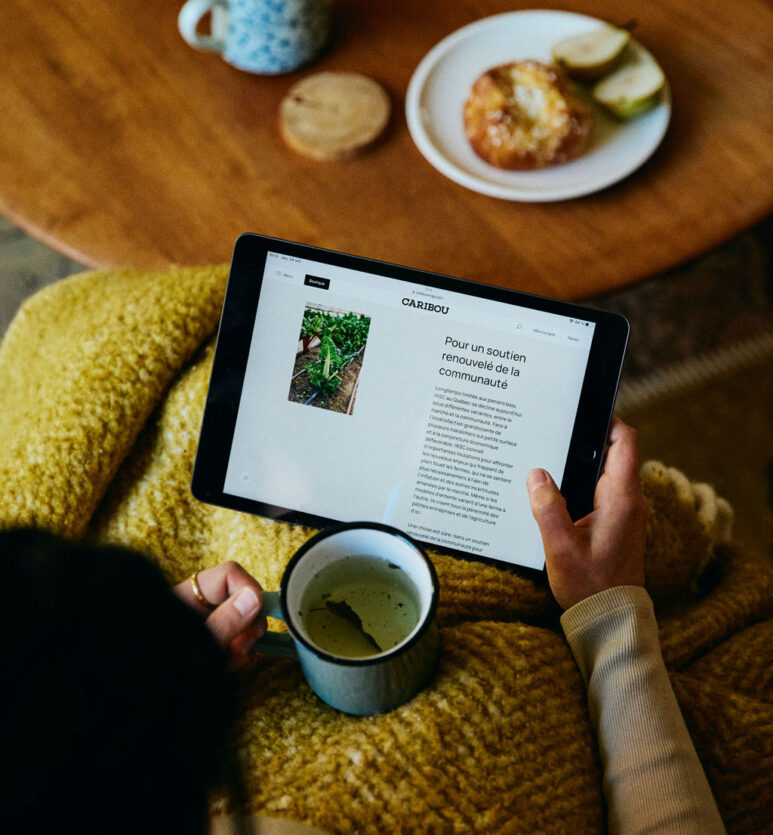En septembre dernier, l’Institut de recherche en économie contemporaine (IREC), en collaboration avec Équiterre, le Collectif Vital et la Chaire de recherche du Canada sur les inégalités en nutrition et santé, rapportait que «l’autonomie alimentaire du Québec telle que développée depuis un demi-siècle ne permettra pas de nourrir la population de manière saine et durable dans les prochaines années».
L’étude a été déclenchée pour répondre au discours politique actuel en matière d’autonomie alimentaire. «On trouvait que la vision du gouvernement était claire sur une chose seulement: l’autonomie alimentaire en termes économiques», affirme l’agronome et analyste en agriculture et systèmes alimentaires chez Équiterre, Carole-Anne Lapierre. «On ne se demandait pas suffisamment si ce qu’on mange et la façon dont c’est produit, c’est sain pour notre santé et pour celle de notre planète.»
Les principaux problèmes? D’abord, le secteur bioalimentaire est un important pollueur: pensons aux émissions de gaz à effet de serre, à la diminution de la biodiversité, à l’appauvrissement des sols ou à la pollution de l’eau et de l’air. Ensuite, les auteurs de l’étude soutiennent que les aliments ultra-transformés ne devraient pas être au cœur du modèle provincial d’autosuffisance. «Financer des entreprises produisant ces aliments, peu durables et peu nutritifs, au nom de l’autonomie alimentaire du Québec n’est […] pas cohérent ni porteur pour l’avenir», dénonce Équiterre.
L’étude propose donc plusieurs pistes de solutions pour combler les lacunes ciblées.
Faire le pont entre santé et écologie
«À long terme, on aura beau produire plus d’aliments ici, si ces aliments-là contribuent aux maladies chroniques parce qu’ils ne sont pas sains, on n’est pas plus avancé», avance Carole-Anne Lapierre. Elle rappelle que Québec a octroyé 3 millions de dollars pour augmenter la capacité de production de croustilles à PepsiCo en 2022. Selon l’agronome, il s’agit d’un exemple où le gouvernement a négligé des «aspects fondamentaux», parce que même si l’entreprise est établie au Québec, l’apport nutritif des aliments qui y sont transformés ne s’inscrit pas dans un modèle d’autonomie alimentaire sain.
En s’appuyant sur l’analyse de filières d’aliments ultra-transformés, soit les croustilles, les pizzas congelées et le yogourt, l’étude de l’IREC propose des modifications dans le système alimentaire local. Selon le rapport, le fait d’apposer des étiquettes locales sur des produits transformés «porte atteinte à la capacité des consommateurs de faire des choix éclairés». Les consommateurs n’ont alors aucun moyen de «connaître la provenance des ingrédients utilisés» ou encore «les pratiques agricoles appliquées».
D’où l’importance de mettre de l’avant davantage d’aliments peu transformés et de les rendre attrayants, illustre Carole-Anne Lapierre. Grâce à une approche filière, «on devrait encourager les gens à manger moins transformés et [inciter] le transformateur à ne pas sur-transformer les aliments», énonce-t-elle.