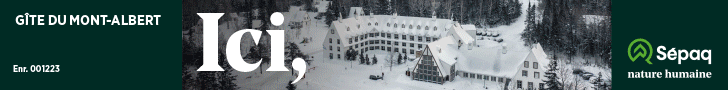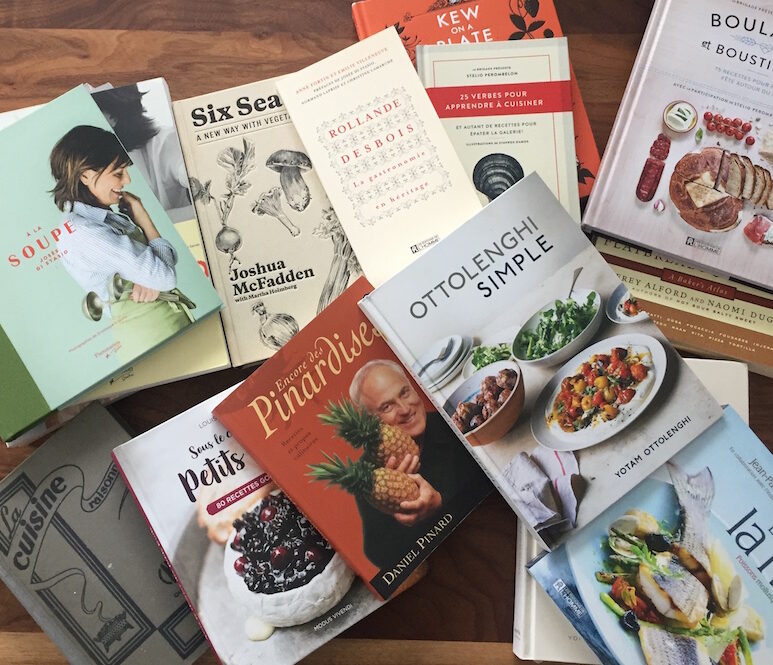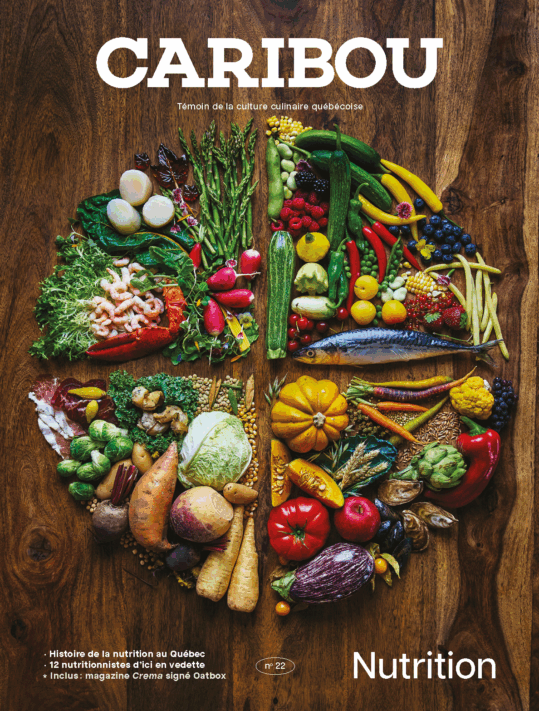La récolte du foin de mer
Publié le
15 octobre 2020

Il se trouve aux abords du fleuve Saint-Laurent, des environnements foisonnants de vie que l’on appelle des milieux humides. Sis entre terre et eau, ces parages de prédilection débordent d’une nature à préserver, mais aussi d’histoires alimentaires à raconter. Parmi les récits de pêche, de chasse et de cueillette, une fenaison inusitée: celle du foin de mer.
Texte d’Alex Cruz et Cyril Gonzales, d’École B
Illustrations de Matthieu Goyer
La qualité de celui-ci étant tributaire de la marée haute, les étapes de sa récolte, puis de son séchage requéraient, on l’imagine, un certain sens du timing.
Ces amas d’herbes salines que l’on récoltait, notamment sur une batture du fleuve Saint-Laurent qui relie toujours l’Isle-aux-Grues à l’Île-aux-Oies étaient composés de plantes sauvages tels que le scirpe d’Amérique, le carex, la spartine maritime, et aussi de celle que l’on appelait par là-bas la rouche (juncus bulbosus).
Une fois fauché, le foin de mer était mis à sécher au-dessus d’une structure sur pilotis que l’on appelait selon certains endroits une allonge ou encore une mûle (meule).
Une fois la marée remontée, ces immenses piles de foin de mer échafaudé donnaient l’impression que d’énormes bisons flottaient sur la prairie nouvellement inondée. Sachez tout de même que nous sommes loin de l’activité anecdotique ici.
La récolte et le commerce de foin de mer le long de l’estuaire du Saint-Laurent auront été chose du quotidien pour de nombreuses familles riveraines, et ce, pendant des centaines d’années au Québec.
En 1861 par exemple, ce serait près de 2075 tonnes de foin de mer qui auraient été récoltées dans l’archipel de l’Isle-aux-Grues, ce n’est pas rien!
Ce sujet vous intéresse? Voici notre humble suggestion de deux lectures qui vous permettront peut-être d’en apprendre davantage sur l’histoire de la fenaison du foin de mer au Québec:
- Le haut marais de l’Isle-aux-Grues: un exemple d’exploitation et de développement durables de Catherine Plante, Matthew Hatvany et Najat Bhiry
- Les Quatre Saisons dans la vallée du Saint-Laurent de Jean Provencher

À lire aussi dans le Carnet d’École-B
- Une catalogne à métisser
- La dinde de Murray Bay
- Un pain de ménage à trancher
- La ruée vers l’eau
- À l’origine de la sagacité d’Amérique
- L’Al Capone du Québec
- Châtaignes rôties d’ici
- Armand Savignac, le précurseur
- Riz frit & toast de Rouyn
- L’histoire de la fraise de jardin du Québec
- La pêche… au goéland
- La corvée de l’épluchette de blé d’Inde
- Une femme et son May West
- Quand l’industrie traditionnelle du lait a dû se réinventer
- L'art du lard salé
Plus de contenu pour vous nourrir